
01-12-2017
Alexandra Kollontai – révolutionnaire et féministe
En Russie, le 8 mars 1917, Journée internationale des femmes (23 février 1917 selon le calendrier grégorien), des ouvrières du textile déclenchent la révolution russe. Après un hiver de misère insupportable, ouvrières et ménagères défilent dans les rues de Petrograd pour réclamer du pain, le retour de leurs maris partis au front, la paix et… la république. Cela malgré des consignes du parti bolchévique de ne pas manifester. Un grand nombre d’ouvriers des usines se joignent à la grève et participent à leur cortège. Ce fut « le premier jour de la Révolution » comme le reconnaît Trotski dans son Histoire de la révolution russe. Du textile, la grève s’étend rapidement à tout le prolétariat de Petrograd. Les manifestantEs scandent « du pain », suivi de « paix immédiate », puis « à bas le tsar ». La grève de masse se transforme en insurrection, lorsque la garnison rejoint les insurgés, les soldats se rangent du côté des manifestants et en cinq jours le régime autocratique est balayé.
Les femmes ont donc joué un rôle important dans la chute du régime tsariste et ont également été protagonistes dans les premières années de l’élan révolutionnaire où tout semblait possible. Aujourd’hui, si on parle de révolution russe on y associe surtout des hommes, comme Lénine, Trotski, Kamenev, Kerenski et j’en passe. Rarement, ou entre parenthèses, on mentionne Krupskaja, Inessa Armand et Alexandra Kollontai. Ce fut la dernière qui avait les idées les plus avancées sur la libération des femmes, notamment en ce qui concerne la libération sexuelle.
Kollontai et la révolution de 1905
Alexandra Domontowitsch est née à Saint Petersbourg en 1872, fille d’un général russe, elle était mariée à Vladimir Kollontai, dont elle porta le nom, mais s’éloignait de lui comme elle s’intéressait de plus en plus aux idées révolutionnaires. Elle étudiait la psychologie de l’enfance et les théories d’éducation (Froebel). Une expérience clef pour elle fut la grève de 1896 des ouvrières du textile. Elle partit étudier l’économie politique à Zurich et écrivait une « Histoire du mouvement des femmes ouvrières »[1] où elle décrivit le militantisme des femmes de St. Pétersbourg dans les années 1890. Dans un texte de 1920 « Pour une histoire du mouvement ouvrier féminin de Russie »[2] elle reprend ses idées de l’époque :
« Il convient de noter que les vagues spontanées de grèves qui, dans les années 1870 et au début des années 1880, poussèrent le prolétariat russe à l’action, touchèrent en particulier l’industrie textile, où une force de travail féminin à bon marché était invariablement employée …/… Il n’en était pas moins extraordinaire que la jeune travailleuse, politiquement naïve et ployant désespérément sous le poids de rudes, d’insupportables conditions de travail, méprisée par tous (même par la moitié féminine de la petite-bourgeoisie urbaine dont elle différait par sa ferme fidélité aux vieilles traditions paysannes) soit à l’avant-garde, combattant pour les droits de la classe ouvrière et pour l’émancipation des femmes ».
En 1905, après le dimanche rouge, où des centaines d’ouvriers et d’ouvrières manifestant paisiblement furent massacrés par les forces tsaristes, l’exclusion des femmes des élections des députés ouvriers de la commission Chidlovsky, instaurée par le tsar pour examiner les raisons de ce massacre (sic !), fut la source d’un profond mécontentement entre elles.
« Les députées ouvrières ne sont pas autorisées à siéger à la commission dont vous avez la présidence. Cette décision est injuste. Dans les usines et fabriques de Saint-Pétersbourg, il y a plus de femmes que d’hommes. Le nombre de femmes employées dans les usines textiles augmente chaque année. Les hommes se dirigent vers les usines offrant de meilleurs salaires. La charge de travail des femmes est plus lourde. Les employeurs profitent de notre impuissance et de notre absence de droits. Nous sommes plus mal traitées que les hommes et payées moins qu’eux. Quand cette commission a été annoncée, nos cœurs se sont remplis d’espoirs ; enfin, avons-nous pensé, le moment approche où l’ouvrière de Saint-Pétersbourg pourra s’adresser à la Russie entière et, au nom de toutes ses sœurs ouvrières, révéler l’oppression, les insultes et les humiliations dont nous souffrons et auxquelles les ouvriers hommes ne connaissent rien. Et alors que nous avions déjà choisi nos représentantes, nous avons été informées que seuls des hommes pouvaient être élus députés »
Le droit de vote et les féministes « bourgeoises »
La question du droit de vote pour les femmes demeurait un sujet d’actualité, en Europe comme en Russie, où des organisations de « femmes bourgeoises » collectaient des signatures y compris dans les milieux ouvriers où la pétition fut massivement signée.
Kollontai explique cela par le fait que « les ouvrières commençaient à prendre conscience de leur statut politique inférieur en tant que femme, mais étaient encore incapables de mettre cela en relation avec la lutte générale de leur classe. Elles avaient encore à trouver le chemin qui mènerait à la libération des femmes prolétaires. Elles s’accrochaient encore aux jupons des féministes bourgeoises. Les féministes usaient de tous les moyens possibles pour établir des contacts avec les ouvrières et les gagner à leur cause. Elles essayèrent de recueillir leur soutien et de les organiser au sein d’unions prétendument situées « au-delà des classes », mais qui étaient en fait bourgeoises de part en part. Cependant, un sain instinct de classe et une profonde méfiance à l’égard des « dames » préservèrent les ouvrières du féminisme et empêcha toute relation durable et solide avec les féministes bourgeoises. »
Même si, à l’époque, il est vrai qu’un gouffre séparait les intérêts des femmes de la bourgeoisie de ceux des ouvrières, il n’en reste pas moins qu’il y avait des revendications qui les unissaient, ce que Kollontai n’admettait pas, elle défendait la suprématie absolue des intérêts de classe et se moquait du « féminisme » bourgeois. L’aspiration à l’« action indépendante » formulée par les féministes bourgeoises était selon elle secondaire. Leurs préoccupations étaient étroites et elles formulaient « des « revendications féminines » exclusivement. Les féministes ne pouvaient pas comprendre la dimension de classe du mouvement embryonnaire des ouvrières. » Elle ne voyait pas que la naissance d’un mouvement féministe même dans les classes bourgeoises était elle-même le fruit d’une époque révolutionnaire, et que les revendications féministes allaient aussi à l’encontre du régime autocratique tsariste. Par ailleurs, elle se souciait que même des sociales-démocrates, des menchéviks et… quelques bolchéviques sympathisaient avec les nouvelles organisations féministes créées après 1906. « À cette époque, la position à présent acceptée par tous – que, dans une société fondée sur les contradictions de classes, il n’y a pas de place pour un mouvement des femmes embrassant sans distinction toutes les femmes – devait être conquise de haute lutte. Le monde des femmes est divisé, comme celui des hommes, en deux camps : l’un est, en termes d’idées, d’objectifs et d’intérêts, proche de la bourgeoisie, l’autre du prolétariat, dont les aspirations à la liberté renferment l’entière solution de la question féminine. Ainsi, les deux groupes, bien qu’ils partagent le slogan général de la « libération des femmes », ont des objectifs différents, des intérêts différents et des méthodes de lutte différentes. »
Entretemps, les revendications sur les droits civiques faisaient tâche d’huile chez les ouvrières qui se les appropriaient tout naturellement.
Lettre à la première Douma en 1906 : « En ce grand moment de lutte pour les droits, nous, les paysannes du village de Nagatkino, saluons les représentants élus qui expriment leurs suspicions à l’égard du gouvernement en réclamant la démission du ministère. Nous espérons que les représentants soutiendront les membres du peuple, leur donneront des terres et la liberté et ouvriront les portes des prisons pour libérer ceux qui combattent pour la liberté et le bonheur du peuple. Nous espérons que les représentants obtiendront les droits civiques et politiques pour eux-mêmes et pour nous, les femmes russes, qui sommes traitées avec injustice et privées de droits, y compris au sein de nos familles. Souvenez-vous qu’une esclave ne peut être la mère d’un citoyen libre. » (Soixante-quinze femmes de Nagatkino.)
Kollontai est d’avis que « les femmes du prolétariat …/… ne considèrent certainement pas les hommes comme des ennemis ou des oppresseurs. Pour elles, les hommes de la classe ouvrière sont des camarades qui partagent la même triste existence ; ce sont de fidèles combattants dans la lutte pour un avenir meilleur. Les mêmes conditions sociales accablent les femmes et leurs camarades masculins, les mêmes chaînes du capitalisme pèsent sur eux et assombrissent leur vie. Il est vrai que certaines spécificités de la situation présente engendrent un double fardeau pour la femme, et les conditions d’emploi de la main-d’œuvre font que, parfois, la femme est perçue comme l’ennemi plutôt que comme l’ami des hommes. La classe ouvrière comprend néanmoins cette situation. »[3]
A cause de la répression farouche contre les révolutionnaires, Kollontai dut quitter la Russie durant les années 1907-1917. Elle visita l’Allemagne, y participa au Congrès international de l’Internationale socialiste, précédée d’une conférence des femmes socialistes, où justement la question du droit de vote fut vivement débattue. En Autriche, où le droit de vote pour les ouvriers masculins n’était pas encore acquis, les hommes socialistes argumentaient de revendiquer d’abord le droit de vote pour les hommes et puis celui pour les femmes. Clara Zetkin, Kollontai et les autres femmes présentes étaient strictement contre cette attitude. Le militarisme et la guerre étaient les autres sujets principaux de ce congrès. Les divergences en cette manière mèneront plus tard à la destruction de la Deuxième Internationale. [4]
Ces discussions influençaient aussi l’effondrement du mouvement de femmes pour le droit de vote où les courants pour ou contre la guerre, le nationalisme et le militarisme ne rendaient plus une action unitaire possible (p.ex. le mouvement des suffragettes en GB). La vision de Kollontai sur les intérêts divergents de classe dans le mouvement des femmes avait donc une part de vérité. Mais elle ignorait aussi les différents courants des suffragettes, comme le groupe de Sylvia Pankhurst qui ne se limitait pas à la revendication du droit de vote, mais exigeait le salaire égal, luttait contre l’arrestation de femmes comme prostituées, parce qu’elles se promenaient seules, gérait une crèche et une fabrique de jouets.
Pendant ses années d’exile elle séjournait également aux Etats Unis, en Angleterre et devenait l’amie de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht, les deux révolutionnaires allemands, qui plus tard se prononçaient contre la guerre, en opposition avec la majorité des socialistEs allemandEs.
La révolution
En 1917, Kollontai rentre en Russie après la révolution de février. En avril, elle soutenait les thèses de Lénine sur la prise de pouvoir immédiate par les soviets, la conquête de la majorité pour les bolchéviques dans les soviets et la fin de la guerre etc… Elle devenait la première femme membre du Comité central et après la révolution, Ministre des Affaires sociales et plus tard responsable pour l’éducation. Ses idées pour la libération des femmes en Russie et surtout pendant les premières années révolutionnaires sont indéniables. Dès la prise de pouvoir, les bolchéviques ont introduit des changements majeurs pour la condition des femmes, au travail et dans la vie quotidienne. Assurance-maladie gratuite, création d’un Département pour la protection de la maternité et de l’enfance. En six mois, la dominance de l’Eglise sur le contrôle des mariages fut balayée par l’introduction du divorce par consentement mutuel, et l’égalité des femmes devant la loi dans tous ses domaines fut établie. Un véritable exploit dans un pays rétrograde soumis à une répression féroce tel qu’était la Russie de l’époque avant la révolution. Des équipements collectifs étaient créés pour permettre aux femmes de se libérer des tâches domestiques ingrates en vue d’une socialisation du travail domestique. Mais les femmes de la campagne opposaient parfois une grande résistance aux tentatives d’en haut pour abolir les divisions sexuelles du travail. Dans les villes, les ouvrières étaient plus enclines à envisager un changement dans les relations familiales et à accepter des cantines et des crèches, étant donné que par les conditions de travail difficiles la famille de toute façon se désagrégeait, mais sans qu’une alternative valable de la vie en commun ne se pointe à l’horizon.
La guerre civile faisait rage, beaucoup de révolutionnaires de la première heure avaient disparu, la Russie était isolée, la famine et la pauvreté s’installaient. Kollontai, dans un élan d’enthousiasme sous-estimait la persévérance des attitudes et de la culture anciennes, à l’extérieur comme à l’intérieur du parti. A cause des changements majeurs dans les premières années de la révolution, elle imaginait déjà la disparition de la famille et du travail domestique. Mais la famille redevint le seul havre de paix et de sécurité après les épreuves terribles vécues par la population.
Ses idées sur le marxisme et la libération sexuelle allaient à l’encontre de la morale réactionnaire de beaucoup de ses camarades du parti, à plus forte raison lorsqu’elle faisait partie de l’opposition. En outre, à une époque où une contraception sûre n’était pas accessible, les conséquences de l’amour libre ne pouvaient mener qu’à des situations de détresse pour les femmes. Ses idées dans ce domaine étaient d’avant-garde et non reprises par les masses de femmes russes.
L’avortement ne fut légalisé qu’en 1920. Il était justifié par la « survivance de la morale du passé et des conditions économiques difficiles du présent, qui contraignent de nombreuses femmes à recourir à cette intervention », mais c’était un fléau qu’il fallait faire disparaître. La question de la contraception et du contrôle de la fécondité par les femmes n’était pas posée.[5]
Lors de la discussion sur la marche que devait emprunter la révolution, Kollontai faisait partie de l’Opposition ouvrière et se confrontait avec Trotzki e.a. sur la gestion des entreprises par les ouvriers eux-mêmes ou par une instance centrale, l’Etat. Il s’agissait de la question combien d’autonomie donner aux différents groupes sans mettre en question la révolution elle-même. Lorsque l’Opposition ouvrière fut qualifiée de fraction, ses idées opprimées et que progressivement les purges staliniennes annihilaient physiquement toute opposition, les possibilités d’expérimenter des idées nouvelles, de créer une nouvelle culture s’arrêtaient. Kollontai était mutée au Ministère des Affaires Etrangères et partait en mission en Norvège, au Mexique et en Suède. Elle fut épargnée des purges, parce qu’elle cessait de poser des questions dérangeantes. Elle mourut en 1952 à l’âge de 80 ans.
« Ses arguments pour l’organisation spécifique des femmes, son insistance non seulement sur l’émancipation politique mais aussi sur la situation dans la famille et les effets psychologiques de centaines d’années d’oppression sur la conscience des femmes nous concernent encore maintenant. Son importance pour le contrôle d’en bas, son emphase pour comprendre la création d’une culture nouvelle et la reconnaissance d’une relation entre expérience personnelle et conscience politique sont intéressants pour le mouvement révolutionnaire en général. »[6]
Résistance à l’organisation des femmes par les socialistes
Dans les années 1905-1907, la tentative d’organiser les femmes ouvrières dans des organisations indépendantes ne rencontrait pas mal de résistance dans les partis ouvriers. Kollontai était membre du parti menchévik, mais se dirigeait politiquement vers les bolchéviks. « La direction du parti était absorbée dans des tâches sérieuses et urgentes et, bien qu’elle ait reconnu sur le principe l’utilité de ce type de travail, elle ne fit rien pour aider ou soutenir le travail du groupe. Les camarades de base ne saisissaient souvent pas le sens de ce que nous faisions et identifiaient nos activités à celles du « féminisme abhorré ». Ils ne prodiguaient aucun encouragement et allaient même jusqu’à essayer d’entraver les activités du groupe. » Kollontai essaye de trouver une excuse à cette attitude sans comprendre entièrement qu’avec ses attaques des féministes « bourgeoises », elle avait livré elle-même l’argument contre l’organisation indépendante des femmes ouvrières : « Une telle attitude était fondée sur la peur, aisément compréhensible, que les ouvrières puissent quitter le mouvement de classe auquel elles appartenaient et tomber dans le piège du féminisme. » (sic !)
Néanmoins, les activistes (féministes dirait-on aujourd’hui) socialistes continuaient leur travail d’organisation chez les ouvrières et des clubs foisonnaient partout. Ainsi, en 1908, au Congrès panrusse de femmes, convoqué par les organisations de femmes bourgeoises, 45 femmes des 700 participantes furent des socialistes et 30 d’entre elles furent des ouvrières d’usine.
Reconnaissance du droit d’organisation des femmes jusqu’à sa négation
Le principe d’organisation spécifique des femmes au sein du parti fut graduellement acquis, mais la discussion fut cantonnée à l’organisation à l’intérieur du parti. On n’envisageait pas la possibilité d’un mouvement à l’extérieur du parti, considéré automatiquement comme bourgeois. Cependant, des organisations de femmes social-démocrates avaient existé dans les pays scandinaves dans les années 20, jusqu’à ce que le mouvement communiste international leur ordonne de fusionner avec les organisations du parti. [7]
En Russie, après la révolution, en 1918, au Congrès des ouvrières et paysannes on relevait un réseau national d’organisations de femmes, les « départements » qui recevaient de plus en plus de pouvoir d’initiative. Les Genotdel, comme on les appelait étaient représentées à toutes les instances du parti, elles avaient leurs locaux, éditaient des journaux et défendaient les intérêts des femmes dans le parti, dans les syndicats et dans les soviets.
Avec l’introduction de la NEP, la réduction draconienne des dépenses publiques et la suspension des crédits pour les équipements collectifs, on s’appuyait sur l’impossibilité momentanée de prendre des mesures pour la libération des femmes pour grignoter les droits des départements de femmes. Peu à peu et surtout avec la contre-révolution stalinienne, les genotdel disparaissaient pour finalement être déclarées « superflues », leur journal « Kommunitska » ne paraissait plus et la libération de la femme fut déclarée acquise !
_____________________________________________________________________________________________________________________
[1] Non traduit du russe
[2] Les citations en lettres cursives proviennent de ce texte
[3] Souligné par nous
[4] Alexandra Kollontai
Women Workers Struggle for their Rights
Extrait de l’introduction de Sheila Rowbotham (traduit par nos soins)
[5] Femmes et mouvement ouvrier éditions la brèche, article d’Alix Holt p.109-114
[6] Idem Alexandra Kollontai…
[7] Femmes et mouvement ouvrier … p.126

26-06-2017
Une crise politique rampante
Moins de deux semaines après les élections législatives au Royaume-Uni, les choses ne s’arrangent pas pour le gouvernement conservateur. En perdant sa majorité, Theresa May a beaucoup perdu de son autorité. Le gouvernement engage les négociations de sortie de l’Union européenne dans une situation très défavorable. Les divisions dans son propre parti que May avait réussi à colmater depuis le référendum du 23 juin 2016 resurgissent, y compris au sein du gouvernement. Le Parti travailliste rajeuni est à l’offensive et Jeremy Corbyn réussit à faire taire – provisoirement – la majorité de ses propres opposants.
En convoquant des élections, May avait cherché à élargir sa majorité. Un raz-de-marée aurait été le bienvenu, mais une majorité de 50 ou 60 aurait suffi pour affermir son autorité et éviter des votes à risques. En fait, son calcul n’était pas si faux que cela. Elle a augmenté le pourcentage de son parti de 5,5%, arrivant à 42,4%; il faut revenir à 1983, à l’époque de Margaret Thatcher, pour retrouver un tel score. Mais son calcul a été basé aussi sur le fait que le Parti travailliste resterait bien derrière. C’est là où elle s’est trompée – avec, il faut dire, la quasi-totalité des commentateurs politiques. Et il faut bien comprendre pourquoi. Certes, les faiblesses et incohérences de sa campagne ont joué un rôle. Mais fondamentalement Corbyn a réussi sa percée à cause de son programme socio-économique radical. Tant que le Parti travailliste vivotait à moins de 30% dans les sondages les élites ne se souciaient pas trop de son programme, sinon pour s’en moquer. Par ailleurs, ils ont cru à leur propre propagande, qu’on ne pouvait pas se faire élire avec un tel programme. Corbyn a démontré le contraire.
Maintenait les conservateurs sont confrontés à plusieurs dilemmes. May dépend du soutien des dix députés du DUP, parti des protestants fondamentalistes d’Irlande du Nord, ce qui n’est pas encore acquis. Dans une situation moins compliquée, un gouvernement minoritaire avec le soutien d’un petit parti pourrait survivre au moins deux ou trois ans, même peut-être cinq. Mais la situation est compliquée par le Brexit. Il est difficile d’imaginer ce gouvernement naviguer une série de votes d’ici 2019. Dans le Discours de la reine, qui présente les priorités du gouvernement à l’ouverture du nouveau Parlement, il n’y a donc pas moins que huit projets de loi concernant le Brexit. Il faudrait un gouvernement fort, face à l’UE et à l’opposition interne. Comment y arriver ? Dans certains pays la solution pourrait être une grande coalition. Mais chaque pays a sa propre culture politique et le Royaume-Uni ne fait pas de grandes coalitions. La seule et unique exception était en 1940.
Une nouvelle élection? Ce serait plus logique. Le problème, c’est qu’on ne peut pas garantir le résultat. On peut espérer une victoire conservatrice sous un nouveau dirigeant, mais on peut aussi se retrouver avec le statu quo. Et encore pire, une victoire de Corbyn. Ce qui serait inacceptable pour les classes dirigeantes et au lieu d’offrir une solution au Brexit, cela compliquerait le problème. Le Financial Times cite un ex-responsable de la campagne pour sortir de l’UE: «Si 38% [en fait, 40%] des électeurs optent vraiment pour Corbyn, [qui est] pro-IRA, antinucléaire, pro nationalisation, alors les électeurs du Royaume-Uni ne sont plus assez muris pour la démocratie. Nous ferions mieux de rester à l’UE si on va élire Corbyn». Les propos sont extrêmes. Mais le sentiment d’inquiétude à la perspective d’un gouvernement Corbyn est largement partagé dans les cercles dirigeants.
La référence à l’Union européenne est révélatrice. Les divergences entre les partisans du Brexit et les dirigeants de l’UE sont bien réelles. Mais face à la menace d’un vrai gouvernement de gauche la classe politique britannique, pro- et anti Brexit confondus, ferait front commun avec les institutions européennes.
Corbyn a réussi à faire la campagne électorale en parlant peu du Brexit, indiquant simplement qu’il acceptait le verdict du 23 juin et qu’il ferait le meilleur accord possible, donnant juste l’impression qu’il sera moins rigide que May. Mais s’il est confronté à de nouvelles élections, il aura intérêt à être plus clair. Son programme le mettrait sur une course de collision avec les institutions européennes. Il ferait mieux de l’assumer et expliquer comment il voit l’avenir de la Grande-Bretagne après le Brexit, quels rapports avec l’Europe.
Le gouvernement britannique a sa vision du Brexit. Loin du protectionnisme prôné par Trump ou celui, européen, que Macron semble défendre, il veut un Royaume-Uni libre-échangiste et dérèglementé, mieux équipé pour affronter les défis la mondialisation.
Corbyn a intérêt à développer un contre-narratif. Au fait, il le développe largement en ce qui concerne le pays, mais la question de l’Union européenne est moins abordée. Trois jours après les élections, John McDonnell, ministre des Finances dans le cabinet fantôme et bras droit de Corbyn, répondait à des questions concernant l’attitude des travaillistes à l’égard du marché unique. Il a dit qu’il ne voyait pas comment le parti pourrait être favorable à rester dans le marché unique, parce son programme donnait la priorité à l’emploi. Il ajoutait que son parti respectait le résultat du référendum, ce qui n’était pas compatible avec le maintien dans le marché unique. L’explication est un peu courte. Mais il est parfaitement possible d’expliquer qu’une grande partie du programme travailliste est contradictoire avec les principes des échanges libres et sans entraves, l’opposition aux aides de l’État, etc. Dans un article sur le site du journal Politico, un ancien ministre portugais s’exprime ainsi : «Le débat fondamental n’est plus un combat entre ceux qui s’opposent à ce que la Grande-Bretagne quitte le bloc et ceux qui veulent arracher le sparadrap. La tension réside dans les visions différentes d’où se dirige le pays» (http://www.politico.eu/article/how-a-socialist-brexit-could-reshape-uk-and-europe/ ). C’est une vision un peu optimiste; ce n’est pas encore le débat fondamental pour des millions de gens, mais c’est le débat qu’il faut mener et qui est déjà là en filigrane. Corbyn devrait expliquer comment son programme est contradictoire avec le marché unique et avec son ambition affichée de gouverner «pour le plus grand nombre, pas pour la minorité [des riches]». Cela permettrait aussi de s’adresser aux peuples d’Europe. Ce que le gouvernement britannique est strictement incapable de faire.
L’urgence d’une attitude offensive par Corbyn est soulignée par le fait que 50 de ses propres députés viennent de lancer un appel à rester dans le marché unique. Pour l’instant Corbyn est obligé de vivre avec sa fraction parlementaire. Mais il semble qu’il s’apprête, fort du résultat du 8 juin, à faire du nettoyage dans l’appareil du parti et de renforcer sa position au sein de son Comité exécutif. Il se peut quand même qu’avant qu’il ne puisse le faire, il soit confronté à une élection, si le gouvernement perd des votes sur le Discours de la reine, ou même se trouvait à la tête d’un gouvernement minoritaire.
Le débat sur l’avenir du pays qu’il faut n’a rien à voir avec l’affrontement caricatural entre hard et soft Brexit. «Soft Brexit» est un mot de code pour un Brexit sans Brexit, mis en avant par ceux qui ne voudraient pas de Brexit, mais n’osent pas aller directement contre le vote populaire. Donc ils proposent un «Brexit» tout en restant dans le marché unique. Pour le gouvernement britannique, dans les négociations qui viennent de débuter il ne s’agit pas de soft ou de hard, mais d’un Brexit plus ou moins favorable aux exportateurs britanniques, au flux des capitaux financiers, etc. Le résultat dépendra du rapport de forces, qui s’est brusquement dégradé depuis le 8 juin.
Depuis le 8 juin au Royaume-Uni on assiste à un barrage médiatico-politique visant à présenter le vote du 8 juin comme un vote contre un hard Brexit. Avec peu de preuves. Rappelons que le Brexit était la préoccupation principale pour 48% des électeurs conservateurs (qui soutenaient May), mais seulement 8% de ceux des travaillistes, qui avaient d’autres soucis. Parler du hard et soft, c’est déformer la réalité et essayer de faire oublier la leçon primaire de la campagne électorale: ce sont les questions sociales et économiques qui ont été mises au centre par la campagne du Parti travailliste.
Malgré les meilleurs efforts des anti-Brexit, les lignes ont remarquablement peu bougé depuis le 8 juin. Depuis son limogeage par May en juillet 2016, George Osborne, numéro deux du gouvernement Cameron et putatif successeur de ce dernier, s’est recyclé comme rédacteur-en-chef du journal de soir de Londres Evening Standard, d’où il a mené la vie dure à May pendant la campagne électorale. Mais c’est dans son journal qu’on apprend, le 15 juin, que 70% soutiennent toujours le Brexit (44 % par conviction, 26% parce que le peuple a voté ainsi) et que 52% soutiennent la ligne définie par May en janvier (ni union douanière ni marché unique). En revanche, moins de gens pensent que May est capable de réaliser ses objectifs (37% contre 48% avant les élections). Ce qui est assez logique.
Pour résumer : si les conservateurs continuent à gouverner avec le Parlement actuel, avec ou sans May, ils seront dans une situation de faiblesse, en générale et surtout vis-à-vis de l’UE ; s’ils risquent une élection, le résultat est imprévisible, la porte de sortie n’est pas garantie. On assiste à une crise politique rampante.
Après le 8 juin, on pouvait se demander ce qui pourrait arriver de pire aux conservateurs. La réponse est venue le 14 juin sous la forme de l’incendie d’une tour dans l’ouest de Londres. Les dernières estimations parlent de 79 morts, chiffre qui risque d’augmenter. Il s’agit donc d’une tragédie humaine qui a entraîné la mort de dizaines de personnes, dont de nombreux enfants. Mais cette tragédie jette une lumière crue sur le Royaume-Uni d’aujourd’hui. D’abord, elle a eu lieu dans la commune la plus riche du pays, Kensington and Chelsea. Ensuite, la circonscription qui couvre une grande partie de la commune a pour la première fois été gagnée, de justesse, par une candidate travailliste, qui a centré sa campagne sur les inégalités. Car dans cette commune il y a des gens très riches et des pauvres. Et ce sont les pauvres qui habitaient la tour en question, Grenfell Tower.
Last but not least, l’incendie a mis l‘accent sur la dérèglementation et les coupes budgétaires. La tour consiste de logements sociaux qui appartiennent à la commune, mais qui sont gérés, comme la totalité des logements sociaux de la commune, par un organisme dont la gestion et la volonté de réduire les dépenses ont été beaucoup critiqué. Il semble que l’incendie a s’est répandue à une vitesse fulgurante parce les panneaux extérieurs étaient faits d’une matière combustible. Il paraît que cela coûtait moins cher… Plus largement sont en cause non seulement la question de savoir si les règles sécuritaires ont été bien suivies, mais si ces règles elles-mêmes étaient suffisantes. Des poursuites criminelles restent possibles.
La réaction du gouvernement et de la commune (de droite) pour aider les survivants n’a pas été à la hauteur. May en particulier a été critiquée parce qu’elle a été voir la police et les pompiers, mais pas les résidents survivants. Il y a eu de gros problèmes de relogement des survivants; certains se sont fait proposer des logements loin de Londres, d’autres dorment dans leurs voitures ou dans les parcs. Corbyn est intervenu pour rappeler que les logements existent à Londres. Il y a en effet presque 20,000 logements qui sont vides depuis au moins six mois. Les personnes aisées et les sociétés immobilières les achètent comme un investissement. Cela s’appelle le «land banking». Corbyn a expliqué que ces logements pourraient être occupés, expropriés ou sujets à un achat obligatoire («compulsory purchase»). Il a encouragé les gens à occuper de logements vides.
Ni les conditions dans lesquelles vivaient les locataires, ni la question des normes de sécurité, ni la gestion où l’argent prime sur les besoins humains ne sont un hasard. C’est le reflet parfait de la société britannique après 40 ans de néolibéralisme. Dans un discours du 5 janvier 2012, David Cameron déclarait que sa résolution pour la nouvelle année était de «tuer la culture de santé et sécurité une bonne fois pour toutes», car cela représentait «un albatros autour du cou des entreprises britanniques». Pour inverser un vieux slogan de la gauche radicale: «Nos profits valent mieux que vos vies».

26-06-2017
Après les élections, le combat contre Macron
Les élections en France se suivent et ne se ressemblent pas. À la suite d’une longue et passionnante campagne, plus de 36 millions d’électeurs ont voté le 23 avril, en sachant pour qui et pourquoi. Ils étaient 31 millions pour le deuxième tour et on comprend le nombre de votes blancs et nuls et le niveau d’abstention élevée comme un refus politique de choisir entre Macron et Le Pen.
Les législatives qui viennent d’avoir lieu ont été une tout autre affaire. Seuls 22.65 millions ont fait le déplacement pour le premier tour, le11 juin. Une semaine plus tard, ils étaient un peu plus de 18 millions à voter. Entre les deux tours, le taux d’abstention est passé de 51,3 à 57,36%. Donc moins de 43% des électeurs ont voté au deuxième tour. Du jamais vu, mais cela se comprend. Quand la Constitution a été modifiée pour raccourcir le mandat présidentiel de sept à cinq ans il a aussi été décidé que les législatives suivraient directement les présidentielles. Du coup ces élections ont commencé à se vider de leur sens. Elles étaient là pour confirmer le vote des présidentielles. Cela tendait à faire de l’Assemblée un simple appendice de la Présidence de la République. Face à ce type d’élections, ceux qui voulaient que le président ait une majorité parlementaire votaient pour son parti, ceux qui étaient vraiment motivés à l’en empêcher ont voté autrement. Et de plus en plus nombreux, les gens n’ont pas voté du tout. Le taux d’abstention a augmenté à chaque élection, passant de 32% en 2002 à 57% en 2017.
C’est la première raison, structurelle, qu’il faut prendre en compte pour expliquer le taux d’abstention. Mais il y a une raison spécifique à cette élection, que nous avons citée dans des articles précédents: la victoire d’Emmanuel Macron a des pieds d’argile. Nous l’avons déjà vu au deuxième tour de l’élection présidentielle: ce qui a fait élire Macron, ce sont ceux qui ne voulaient pas voter pour lui, mais contre Le Pen. Mais dans les élections législatives, le parti de Macron, REM, avec ces alliés centristes du MoDem, ont obtenu 32,3% des voix exprimées, c’est-à-dire moins de 16 % des inscrits. Pour le programme antisocial ambitieux du nouveau président, c’est une base extrêmement faible. Et autant on comprenait ceux qui ont refusé de choisir le 7 mai, autant on ne sait pas ce que pensent ceux qui n’ont pas voté aux législatives. Ils n’ont pas voulu voter pour Macron, ni contre. Pourtant, ils existent. Ils travaillent, ils sont au chômage, ils font des études, ils sont à la retraite. Mais ils existent, ils pensent, ils seront touchés par les mesures du nouveau gouvernement, ils peuvent agir. Et leur apathie apparente peut se transformer en colère. Ce que Jean-Luc Mélenchon a bien compris dans son discours à Marseille le soir du 18 juin.
Le système électoral français est particulièrement cruel à l’égard de minorités, encore pire que celui d’outre-Manche. Le rapport entre le nombre de voix et le nombre de sièges varie énormément. Ainsi avec un peu plus de 7 millions de voix au premier tour, le bloc REM-MoDem a 350 sièges. La France insoumise, avec 2, 5 millions de voix, a 17 sièges; le PCF, avec un peu plus de 600,000 voix, 11 sièges; et avec 1,68 million, le PS et ses alliés en ont 44.
Il s’est passé quand même quelque chose entre le premier et deuxième tour. Sur la base du premier tour, les estimations allaient jusqu’à 450 à 475 sièges pour le bloc présidentiel. La gauche radicale n’était pas sure d’avoir un groupe, même en additionnant les forces de LFI et du PCF. Et le Front national n’était pas sûr de dépasser ses deux sièges dans l’Assemblée sortante. Les résultats du 11 juin ont infirmé ces prévisions. La gauche aussi bien que le Front national ont fait mieux que prévu, le bloc macroniste moins. On peut supposer qu’au deuxième tour il y a des électeurs macronistes qui n’ont pas voté, pensant peut-être que l’affaire était déjà dans le sac. Et que des électeurs FN qui s’étaient abstenus au premier se sont mobilisés au second. Et qu’à gauche la mobilisation des électeurs et les reports de voix ont était suffisants pour éviter le pire et même en sortir la tête haute.
À l’arrivée le Front national a eu huit élus, avec un triomphe personnel pour Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Cela lui donne un peu de marge de manœuvre et le met dans une meilleure situation pour aborder le débat sur le bilan des présidentielles et surtout celui, inéluctable, sur la stratégie future du FN.
À gauche, LFI avec ses 17 élus était tout de suite capable de former un groupe. Le PCF en a onze. En fait, c’est plus compliqué que simplement LFI ou PCF. Il y a sept élus strictement PCF, plus trois PCF soutenus par LFI, dont Marie-George Buffet. Il y a deux avec la double investiture, Clémentine Autain et François Ruffin. Cinq des nouveaux députés appartenant à d’autres partis ont signé la Charte de LFI: deux PCF, une Ensemble, deux Réunionnais. Enfin, il y a douze députés purement LFI. Le chiffre de 17 avancé pour un groupe LFI à l’Assemblée comprend les trois dernières catégories. Quand le PCF donne un chiffre de onze élus, il compte manifestement sur l’un de ceux qui ont signé la Charte. Il semblait possible et souhaitable qu’il y ait un seul groupe LCI-PCF. Du côté du PCF, on aurait pu penser que la décision serait prise par le Conseil national de ce parti qui aura lieu les 23 et 24 juin. Mais on vient d’annoncer par la voix d’André Chassaigne qu’il n’y aurait pas de groupe commun avec LFI, mais un groupe PCF avec les quatre députés d’outremer qui s’étaient déjà alliés avec lui au dernier Parlement.
Au-delà des questions d’alliances il faut apprécier les succès de LFI et du PCF. LFI a pris les deux sièges du département de l’Ariège, où Mélenchon était arrivé en tête le 23 avril. Il a remporté six des 12 sièges pour le département emblématique de Seine-Saint-Denis, auxquels il faut ajouter celui de Marie-George Buffet. LFI a aussi pris un siège tenu historiquement pas le PCF en Val-de-Marne et Elsa Faucillon récupère pour le PCF le siège de Gennevilliers-Colombes, perdu en 2012. Dans le Nord il y a deux députés PCF et deux LFI. En Meurthe-et-Moselle Caroline Fiat remporte le seul duel LFI-FN. André Chassaigne du PCF est réélu avec 63% de voix dans le Puy-de-Dôme. Jean-Luc Mélenchon remporte un siège à Marseille avec presque 60% des suffrages. Pour LFI, mouvement qui a été créé en février 2016 ses résultats sont, dans les circonstances difficiles de ces élections, un triomphe. Aux 17 élus il faut ajouter de très bons résultats aux premier et deuxième tours. Au premier tour LFI a distancé le PCF dans la grande majorité de circonscriptions, y compris dans certains de ses anciens bastions. Pour le PCF le résultat est un soulagement par rapport aux prévisions. Le débat sur le bilan des deux campagnes électorales et les perspectives devrait être moins tendu.
Un des axes de campagne d’Emmanuel Macron était la promesse de rompre avec la corruption et les scandales qui ont éclaboussé aussi bien la droite que le PS, de moraliser la vie publique et d’avoir un gouvernement exemplaire à cet égard. Il semble que ce n’est pas si facile. Nous avons déjà parlé du cas de Richard Ferrand, qui va maintenant quitter le gouvernement, apparemment à la demande de Macron, et qui est préconisé pour être président du groupe REM à l’Assemblée. Ensuite, trois représentants du MoDem, dont son chef de file, François Bayrou, vont aussi se retirer du gouvernement; leur parti est accusé d’avoir créé des emplois fictifs. Potentiellement plus grave, le 20 juin la police anticorruption a fait une perquisition au siège du groupe publicitaire Havas, concernant un voyage de Macron à Las Vegas en 2016, quand il était ministre de l’Économie. Aussi impliquée est l’actuelle ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui avait organisé le voyage. Au niveau du groupe parlementaire du REM on commence à voir les conséquences d’avoir fabriqué un instrument politique de toutes pièces. Il y a maintenant plusieurs nouveaux députés qui se révèlent être embrouillés dans des affaires judiciaires.
Les deux grandes forces traditionnelles, la droite et le PS, ont aussi fait mieux que prévu. Les Républicains (LR) ont 112 sièges, auxquels il faut ajouter 18 pour les centristes de l’UDI. Mais la force d’attraction du macronisme se fait encore sentir. Il y a un nouveau groupe, regroupant l’UDI et une partie de LR, qui serait plus Macron-compatible. Le PS a lui-même 30 sièges plus 14 pour ses alliés divers. Le Bureau national du parti vient de décider que le PS sera dans l’opposition. Reste à voir ce que feront les députés. Le débat sur l’avenir du parti commence et devrait en principe durer jusqu’au prochain congrès, au printemps 2018. Mais les partisans de Benoît Hamon vont se réunir le 1er juillet pour décider s’ils vont rester au PS ou partir pour travailler avec la gauche radicale, notamment LFI. Et d’autres encore seront attirés par Macron.
Pour revenir à la gauche radicale, il ne faut pas se laisser entraîner dans les querelles entre LFI et le PCF. Il semble qu’il y aura maintenant deux groupes. Il y a des raisons à cela. Peut-être cela peut changer à l’avenir. Deux choses semblent essentielles. D’abord, il ne faut pas laisser les arbres des divergences LFI-PCF cacher la forêt. Et la forêt, c’est cette remarquable campagne politique qui, partant de pas grande chose, a su construire un mouvement original, gagner le soutien de 7 millions d’électeurs et qui a raté le deuxième tour de quelques centaines de voix. En cours de route LFI a pu attirer le soutien de forces politiques qui au départ avaient d’autres projets. De cette expérience d’une campagne politique de masse, il faut apprendre. Tout en gardant des rapports fraternels avec d’autres forces politiques et notamment le PCF.
Ensuite, il y aura des batailles à mener contre la politique de Macron, en premier lieu pour résister à son offensive contre le Code du travail. L’unité la plus importante est celle qu’il faut construire au cours de cette lutte et d’autres encore. Le discours de Mélenchon le 18 juin était tout axé sur les luttes et la résistance, avec l’appel à un «nouveau front populaire politique, social et culturel». Ce qui comprendra forcément le PCF, les autres forces de gauche vives, les syndicats, les associations. Le terrain électoral a donné ce qu’il a pu, et c’était beaucoup. Maintenant il faut faire la suite dans la rue, dans les quartiers, sur les lieux de travail.

15-05-2017
Algérie, l’autre 8 mai 1945
Ce jour là, dans toute l’Algérie, des manifestations sont organisées pour fêter la victoire des alliés mais aussi pour rendre hommage aux nombreux soldats algériens engagés dans la guerre en Europe. Marseille et Toulon ont été libéré par des régiments de tirailleurs algériens et plusieurs milliers d’entre eux trouveront la mort en France, en Allemagne ou en Italie.
La revendication nationale ayant pris de l’ampleur en Algérie pendant la guerre, le Parti du peuple Algérien donne aux défilés une forte connotation indépendantiste.
A Sétif, c’est le drapeau algérien qui met le feu aux poudres. Le préfet ayant ordonné aux forces de police de «tirer sur tous ceux qui arborent le drapeau algérien», le commissaire ne se fait pas prier: il fait tirer sur les manifestants. Le premier manifestant tué est un jeune scout, Bouzid Saâl. Pacifiques, les manifestations dégénèrent en émeutes et 102 européens sont tués. La répression de l’armée française intervient brutalement dans toute la région. Manifestants fusillés sommairement par centaines, femmes violées… L’aviation mitraille et bombarde les villages de montagne. Les navires de la marine bombardent les douars de la montagne kabyle. Et les colons, organisés en milices, participent aux massacres. Le général Tubert, membre de la commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements, avance le chiffre d’environ 1000 morts, mais les historiens s’accordent à parler de 20 000 à 30 000 victimes… De par la radicalisation que ces massacres ont engendrés, certains historiens les considèrent comme le véritable début de la guerre d’Algérie. L’écrivain algérien Kateb Yacine, lycéen à Sétif à cette époque l’exprime ainsi: «C’est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J’avais vingt ans. Le choc que je ressentis devant l’impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l’ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme.»
Reconnaissance tardive par la France
La France n’a jamais reconnu officiellement les massacres jusqu’en mars 2005, soit plus de 40 ans après l’indépendance, quand l’ambassadeur de France en Algérie, Hubert Colin de Verdière parla des massacres de Sétif comme d’une «tragédie inexcusable». Et c’est François Hollande qui fut le premier chef de l’État à reconnaître les massacres et de déclarer, lors d’une visite à Alger en décembre 2012: «Pendant cent trente-deux ans, l’Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Parmi ces souffrances, il y a les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata.»
Malgrè cette reconnaissance symbolique importante vu le contexte, la France reste enfermée dans une logique néo-coloniale vis-à-vis de ses anciennes colonies et la droite et l’extrême droite semble toujours décidée à imposer son Histoire officielle et continuer à vanter le «rôle positif de la présence française outre-mer»…

21-03-2017
Pays-Bas: une défaite pour Wilders, mais pas pour la droite
Les élections législatives aux Pays-Bas ont eu lieu le 15 mars, les premières dans une série qui se poursuivra en avril-mai-juin en France et en septembre en Allemagne.
A l’issue du scrutin, pas moins de 13 partis se trouvent représentés au Parlement. C’est dû en partie au mode de scrutin, à la proportionnelle intégrale. Mais aussi à l’affaiblissement de l’adhésion des électeurs aux grands partis traditionnels, ce qui libère des espaces et donne à la vie politique néerlandaise un caractère volatile et imprévisible, loin de la stabilité qui a marqué les décennies après 1945. C’est évidemment la conséquence des années de crise, de l’austérité, des attaques contre l’Etat social, du creusement des inégalités, dont la responsabilité est partagée par les partis de gauche et de droite.
C’est dans ce contexte que nous avons vu la montée de formations de droite «populiste», d’abord celui de Pim Fortuyn, assassiné en 2002, ensuite le PVV de Geert Wilders. Nous utilisons le mot «populiste» parce qu’il fait partie du débat politique, mais il convient de le manier avec prudence. Il rivalise avec «eurosceptique» comme mot qui obscurcit plus qu’il n’éclaire; et il est utilisé par les gouvernants de l’Europe et les média pour désigner tous ceux, à gauche aussi bien qu’à droite, sortent du cadre de ce qui a été appelé «l’extrême centre» de la politique néolibérale, dont l’adhésion acritique à l’Union européenne fait partie intégrante.
Le premier enjeu des élections néerlandaises était de savoir qui, du parti de Wilders ou de celui du Premier ministre sortant, Mark Rutte, le VVD, allait sortir vainqueur, c’est-à-dire avec le plus de voix et de sièges (car personne ne pouvait aspirer d’être majoritaire). Pendant un moment les sondages donnaient Wilders vainqueur et ce dernier se précipitait à vendre la peau de l’ours avant de l‘avoir tué, en multipliant les déclarations triomphalistes. En fin de compte le VVD a obtenu 33 sièges (sur 150) et le PVV 20. En fait, le parti de Rutte avait perdu par rapport à 2012 un quart de ses voix, 8 sièges et 5% des suffrages. Et le PVV a gagné 5 sièges et 3% des suffrages de plus. Néanmoins l’objectif de Wilders était d’arriver le premier et l’objectif de Rutte (et de tout l’establishment politique) était de l’en empêcher: il s’agit donc d’un sérieux revers pour Wilders.
Les résultats étaient accueillis en Europe avec beaucoup de soulagement, comme l’ont témoigné les déclarations de Merkel, Hollande et Juncker, entre autres. Dans un premier temps les média n’hésitaient pas à parler d’une grande victoire contre le populisme. Cela n’a duré que moins de 24 heures et puis ils ont commencé à dire que c’était plus compliqué que cela. A juste titre, comme on verra.
Malgré ses pertes, Rutte est donc sorti vainqueur et aura très probablement la tâche de former un nouveau gouvernement. Il a perdu des plumes, mais comme l’a dit le correspondant du Financial Times à La Haye, il a eu «une défaite très réussie». Il en sort en nettement meilleure forme que son partenaire au gouvernement depuis 2012, le PvdA, social-démocrate, dont les résultats ont été franchement catastrophiques. Il est tombé de 24,8% à 5,7% et de 38 sièges à 9. Le VVD a pu limiter les dégâts, car le gros de sa base conservatrice a compris sa politique d’austérité. Ce n’était pas le cas de l’électorat populaire du PvdA, qui a plus souffert de cette politique.
Qui a donc vraiment gagné? A droite et au centre, il y avait le CDA (démocrates-chrétiens) et les libéraux centristes du parti D66. Ils ont tous les deux progressé de 4% et se trouvent avec 19 sièges chacun. L’autre gros gagnant, en fait le plus gros gagnant, est le parti de la Gauche verte, qui est passé de 2,3% en 2012 à 8,9%, arrivant même en tête à Amsterdam. C’est le résultat de la campagne menée par son nouveau dirigeant, Jesse Klaver, qui a fait le choix de s’opposer frontalement à Wilders sur les questions de l’Europe et de l’immigration, et qui a absolument réussi son pari. Depuis mercredi, dans les média internationaux, on parle systématiquement des «Verts». Or, la Gauche verte est bien verte, elle a une dimension écologique conséquente. Mais elle est aussi de gauche: elle a ses racines dans la convergence d’eurocommunistes, écologistes et autres au début des années 1990, suite à la dissolution du Parti communiste. Elle est restée pendant des années assez marginale, avant de renaître au cours de cette campagne. Le Parti socialiste (SP), gauche radicale, est resté stable, avec 9,2% et 14 sièges, un de moins qu’en 2012.
Défaite du «populisme»?
Revenons à la «défaite du populisme». Le cœur du discours de Wilders est dirigé contre les immigrés. C’est avant tout un discours islamophobe, les deux grandes communautés immigrées aux Pays-Bas étant turque et marocaine: il parle de fermer les mosquées et d’interdire l’entrée au pays aux Musulmans, en utilisant des termes comme «racaille marocaine». Il prône aussi la sortie de l’Union Européenne, mais cela fait partie aujourd’hui du débat mainstream aux Pays-Bas. Mais la xénophobie et le racisme ne se limitent pas au parti de Wilders. Il y a un déplacement à droite du discours sur l’immigration (entre autres sujets). En grande partie sous la pression de Wilders, certains de ses thèmes sont repris, en des termes plus modérés, par certains partis de droite. C’est notamment le cas du VVD et du CDA, qui ont tous les deux droitisé leur discours. Ainsi, Rutte appelle les immigrés à «se comporter normalement ou de partir» et il a salué sa victoire mercredi soir en déclarant que les électeurs avaient rejeté «le mauvais genre du populisme», le sien étant sans doute le bon. Quant au CDA, il prône l’interdiction de la double nationalité. Le discours de ces partis est plus policé, mais le contenu se rapproche de celui de Wilders. En plus, il y a un nouveau venu au Parlement, avec deux sièges: son nom anodin, Forum pour la démocratie, ne devrait pas tromper. Il s’agit d’un parti d’extrême droite dont le but avéré est de défendre essentiellement la même politique que Wilders, mais sans les excès de langage de ce dernier. Son dirigeant, Thierry Baudet, a été le principal organisateur de la campagne victorieuse pour le non dans le référendum sur l’Accord d’Association: une campagne qui n’avait pas grand-chose à voir avec l’Ukraine, mais dont l’objectif était d’infliger une défaite à la politique européenne du gouvernement.
La formation d’un nouveau gouvernement sera sans doute longue et laborieuse. Les deux partenaires les plus évidents du VVD sont le CDA et D66. Mais avec ces trois partis on arrive seulement à 71 sièges. A partir de là il faut soit ajouter le soutien de petits partis de droite, soit inclure la Gauche verte, à supposer que ce parti soit d’accord. Cela semble difficile. La participation à un gouvernement dominé par la droite pourrait mal se terminer pour la Gauche verte; et sa présence pourrait aussi, du point de vue de Rutte, affaiblir la cohésion du gouvernement.
A la fin de la dernière législature, le 23 février, le CDA avait déposé la proposition de lancer une enquête, sous la direction du Conseil d’Etat, pour savoir si les Pays-Bas devaient garder ou abandonner l’euro et dans le deuxième cas, comment le faire. La proposition a été approuvée à l’unanimité. Il faut espérer que cela conduira à un grand débat public, quelque chose qui est trop rare dans l’Union européenne. On entend dire que le résultat des élections a été une victoire des partis «pro-Européens». C’est à nuancer. Deux partis se profilent comme vraiment Européanistes: il s’agit de D66 et de la Gauche verte. Quant au VVD et au CDA, on pourrait les caractériser comme «Euro-pragmatistes»: ils sont pour l’Union européenne tant que cela profite aux entreprises néerlandaises sans coûter trop cher, mais ils pourraient changer d’avis: et ils ne sont certainement pas fédéralistes. Quant au Parti socialiste, il ne prône pas la sortie de l’Union européenne, mais il tient un discours très critique, y compris sur l’euro.
La situation de la gauche au sens large n’est pas bonne: incluant le PvdA, elle a 37 sièges sur 150. Sans pleurer le sort des sociaux-démocrates, on devrait quand même être conscient qu’il s’agit de construire une nouvelle gauche. La Gauche verte a fait un bond en avant, mais ses bases politiques semblent floues. Le Parti socialiste a certes des faiblesses, mais il a aussi des atouts et une force militante. Il devrait s’interroger sur une campagne où il n’a pas réussi à percer.

21-03-2017
France : police partout, justice nulle part!
Les violences policières se sont multipliées en France, ces dernières années, dans les banlieues mais aussi à l’occasion de mouvements sociaux comme les manifestations contre la “Loi Travail”. L’agression d’une rare violence du jeune Théo par 4 policiers à Aulnay, constitue le dernier “dérapage” d’une police de plus en plus brutale dans ses interventions.
Cet événement a suscité l’émoi et la colère de toute une population qui subit au quotidien les brimades, les insultes et les violences policières.
Car ce qui est arrivé à Théo, à Aulnay, est presque incroyable: un contrôle violent, 4 policiers qui s’acharnent sur un jeune désarmé, sans aucune raison apparente, qui lui infligent des sévices et un viol avec une matraque. Résultat: 6 mois d’incapacité de travail! Incroyable mais pourtant pas isolé. Par dizaines, les témoignages d’abus, de sévices se multiplient et sont soigneusement enterrés pour la plupart par la «police des polices», celle-là même qui conteste le qualificatif de viol dans son rapport sur l’affaire Théo.

Pourtant, d’un point de vue pénal, une lésion interne de 10 cm ne permet aucune marge d’interprétation : il s’agit bien d’un viol. Ou alors, d’un acte de torture, selon les critères de la Cour européenne des droits de l’homme. Et le prétexte d’un policier qui aurait cédé à la panique, ne tient pas la route. Sa brigade d’intervention procède régulièrement à des interpellations dans ce quartier, il s’agit donc pour ainsi dire d’un travail de routine, même si, d’après de nombreux témoignages, il s’agit plutôt d’une brutalité routinière.
Impunité
Plus de 1700 personnes subissent des poursuites judiciaires suite à la lutte contre la loi travail tandis que les flics qui attaquaient les lycéens, les tabassaient, n’ont pas été inquiétés, même lorsqu’ils étaient filmés en plein abus de pouvoir. L’été dernier, Adama Traoré a été assassiné par des gendarmes à Beaumont sur Oise, là encore, tout traîne pour protéger les forces de répression. Suite au drame d’Aulnay, les jeunes interpellés ont déjà été jugés. Certains ont été condamnés à des peines de prison ferme, d’autres avec sursis, alors que les policiers qui ont commis l’agression sont toujours en liberté. On peut finalement se demander pourquoi la hiérarchie policière et ses responsables politiques laissent une partie des « forces de l’ordre » commettre des bavures aussi graves sans prendre de mesures fermes pour les réprimer et les empêcher.
Cette affaire montre à quel point le gouvernement laisse volontairement pourrir la situation dans les banlieues défavorisées. L’isolement et les discriminations à l’embauche laissent toute une partie de la jeunesse française dans l’errance et le désespoir. Rester à l’écart des trafics et des coups de matraques requiert des talents d’équilibriste de haut vol. Les manifestations de solidarité qui se sont organisées suite à l’affaire Théo ont montré à la fois le ras-le-bol de la population locale face aux violences policières, mais aussi la solidarité de la jeunesse française, dans plusieurs autres villes, comme à Rouen, Strasbourg ou Bobigny. Les supporters du Werder Brême ont même déployé une banderole en solidarité avec Théo.
Le 19 mars, une grande manifestation contre les violences policières s’est déroulée à Paris, en donnant la parole aux nombreuses victimes et à leurs familles.
Fracture
L’affaire Théo a mis en lumière la fracture béante qui fissure la République: d’un côté des quartiers entiers laissés à l’abandon avec les logements qui se dégradent et les services publics qui disparaissent alors que tant galèrent pour trouver un emploi. 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 5 à 6 millions de chômeurs… De l’autre côté, des fortunes immenses pour les grands patrons (31,2 milliards d’euros de fortune pour Bernard Arnault du groupe LVMH) qu’il suffirait de prendre pour régler tous les problèmes sociaux : logement, santé, emploi…
La violence est aussi (et surtout) économique. Mais lorsque ses auteurs sont pris la main dans le sac, la police est beaucoup plus compréhensive, voire passive à leur égard. Marine Le Pen (qui passe son temps à demander que les « criminels » soient sévèrement punis) en sait quelque chose puisque lorsqu’elle est convoquée pour être entendue concernant des soupçons d’emplois fictifs, elle peut faire la sourde oreille… et rien ne se passe.

21-03-2017
Les défis pour la gauche dans la zone euro
À partir de mai 2010, la dette est devenue un thème central en Grèce et dans le reste de la zone euro. Le premier programme de 110 milliards d’euros mis au point par la Troïka, qui s’est constituée pour son élaboration et son exécution, a brutalement provoqué l’augmentation de la dette publique grecque. Le même processus s’est produit en Irlande (2010), au Portugal (2011), à Chypre (2013) et en Espagne sous une forme particulière. Les programmes avaient cinq objectifs fondamentaux:
1. Permettre aux banques privées |1| de recevoir un soutien public afin de ne pas payer la facture de l’éclatement de la bulle du crédit privé qu’elles avaient créée et éviter une nouvelle crise financière privée internationale de grande ampleur |2|.
2. Donner aux nouveaux créanciers publics |3| qui se sont substitués aux créanciers privés un pouvoir énorme de coercition sur les gouvernements et les institutions des pays périphériques afin d’imposer une politique faite d’austérité radicale, de dérèglementations (à l’encontre de toute une série de conquêtes sociales), de privatisations et de renforcement des pratiques autoritaires (voir le point 5).
3. Préserver le périmètre de la zone euro (cela signifie maintenir dans la zone euro la Grèce et les autres pays de la périphérie) qui constitue un outil puissant aux mains des grandes entreprises privées européennes et des économies qui dominent cette zone.
4. Faire de l’approfondissement des politiques néolibérales en Grèce en particulier, mais aussi dans les autres pays de la Périphérie, un exemple et un moyen de pression sur l’ensemble des populations européennes.
5. Renforcer à l’échelle européenne (tant sur le plan de l’UE que dans chaque État membre) les formes autoritaires de gouvernement sans recourir directement à de nouvelles expériences de type fasciste, nazi, franquiste, salazariste ou du régime des colonels grecs (1967-1974) |4|.
Il faut tirer des leçons de l’échec de la politique adoptée par le gouvernement d’Alexis Tsipras en 2015 pour rompre avec l’austérité. De même, il faut prendre conscience des limites de l’expérience du gouvernement socialiste minoritaire d’Antonio Costa au Portugal |5|.
Pour une orientation alternative sur l’austérité, la dette, les banques et la zone euro Une orientation alternative et favorable aux intérêts des peuples doit à la fois porter sur l’austérité, sur la dette publique, sur les banques privées, sur la zone euro, sur l’opposition aux politiques autoritaires. Le bilan de la période 2010-2016 dans la zone euro est clair : il est impossible de sortir de l’austérité sans apporter des réponses au moins à ces 5 problématiques. Bien sûr, il faut ajouter que l’alternative doit aussi aborder d’autres problèmes, parmi lesquels la crise climatique et écologique, la crise humanitaire liée au renforcement de l’Europe forteresse (qui condamne chaque année à une mort certaine dans la Méditerranée ou ailleurs des milliers de candidats à l’immigration ou/et à l’asile), la crise au Proche Orient. Il s’agit également de lutter contre l’extrême-droite et la montée du racisme. Après l’élection de Donald Trump, mais aussi après l’apparition du mouvement radical qui s’est retrouvé dans la campagne de Bernie Sanders et qui est appelé à se battre en toute première ligne contre Trump et ses projets, la gauche radicale, les mouvements syndicaux, sociaux, féministes et écologiques européens doivent jeter des ponts vers les forces qui résistent aux États-Unis.
Une grande partie de la gauche radicale ayant une représentation parlementaire avait et a encore une perception erronée de l’intégration européenne au travers de l’UE et de la zone euro. Pour le dire simplement, elle voyait dans l’UE et la zone euro plus d’avantages que d’inconvénients. Elle considérait que tant l’UE que la zone euro étaient compatibles avec le retour à des politiques sociales-démocrates, avec un peu moins d’injustice, avec un peu de relance keynésienne.
Il est fondamental sur la base de l’expérience de l’année 2015 de renforcer le camp des forces qui n’entretiennent pas d’illusions sur l’UE et la zone euro et qui mettent en avant une authentique perspective écosocialiste de rupture avec l’UE telle qu’elle est constituée. Il faut partir du constat que l’UE et la zone euro ne sont pas réformables.
En 2015, chacun a pu faire le constat qu’il est impossible de convaincre, sur la base de la légitimité qu’offre le suffrage démocratique et par la simple discussion, la Commission européenne, le FMI, la BCE et les gouvernements néolibéraux au pouvoir dans les autres pays européens de prendre des mesures qui respectent les droits des citoyens grecs ainsi que ceux des peuples en général. Le référendum du 5 juillet 2015 qu’ils ont combattu avec le chantage et la coercition (à savoir la fermeture des banques grecques 5 jours avant le référendum) ne les a pas convaincus de la nécessité de faire des concessions. Au contraire, bafouant les droits démocratiques fondamentaux, ils ont radicalisé leurs exigences.
Certes, en principe, toute une série de mesures devraient et pourraient être prises à l’échelle européenne pour relancer l’économie, réduire l’injustice sociale, rendre soutenable le remboursement de la dette et redonner de l’oxygène à la démocratie. Yanis Varoufakis, en tant que ministre grec des finances, a fait en février 2015 des propositions qui allaient dans ce sens. Il s’agissait d’échanger la dette grecque contre deux nouveaux types d’obligations : 1. des obligations indexées sur la croissance ; 2. des obligations dites ‘perpétuelles’, au sens où la Grèce rembourserait uniquement les intérêts mais à perpétuité |6|. Les propositions de Varoufakis, bien que modérées et parfaitement réalisables, n’avaient, en réalité, aucune chance d’être acceptées par les autorités européennes.
La Commission, la BCE, le FESF ne veulent pas entendre les peuples C’est le cas de toute une série de propositions visant à alléger radicalement le poids de la dette de la Grèce comme celle de nombreux autres pays européens (par la mutualisation des dettes, par l’émission d’eurobonds, etc.). Techniquement, elles pourraient être mises en œuvre mais il faut bien constater que dans le contexte politique et avec les rapports de force qui prévalent dans l’Union européenne, les pays avec un gouvernement progressiste ne peuvent pas espérer être entendus, respectés et encore moins soutenus par la Commission européenne, la BCE, le Mécanisme européen de stabilité. La BCE a les moyens d’asphyxier le système bancaire d’un État membre de la zone euro en coupant l’accès des banques aux liquidités. Comme mentionné, elle en a fait usage en Grèce en 2015. L’Union bancaire et le pouvoir arbitraire de la BCE renforcent les moyens de coercition dont disposent les institutions européennes pour faire échouer une expérience de gauche.
Les traités sont devenus hyper contraignants en matière de dette et de déficit. Dans l’absolu, les autorités européennes, dont le conseil des ministres, pourraient décider d’y déroger en tenant compte de la situation de crise (ils l’ont déjà fait en faveur de gouvernements qui étaient de leur bord |7|) mais il est clair qu’ils n’en ont nullement l’intention. Au contraire, tant ces institutions que le FMI et les gouvernements néolibéraux en place dans les autres pays ont combattu activement le gouvernement grec alors que celui-ci faisait preuve d’une très grande modération (c’est le moins qu’on puisse dire). La plupart des médias et de nombreux dirigeants politiques européens ont pourtant présenté Alexis Tsipras et Yanis Varoufakis comme des rebelles, voire des radicaux anti-européens. La Troïka a combattu l’expérience en cours en Grèce entre janvier et juillet 2015 afin de démontrer à tous les peuples d’Europe qu’il n’y a pas d’alternatives au modèle capitaliste néolibéral.
La capitulation du gouvernement d’Alexis Tsipras 1 ne leur a pas suffi, les dirigeants européens et le FMI ont exigé et ont obtenu du gouvernement Tsipras II d’approfondir les politiques néolibérales en s’attaquant encore un peu plus au système de sécurité sociale, au système des retraites en particulier, en accélérant les privatisations, en imposant de multiples changements sur le plan juridique et législatif qui constituent des reculs structurels fondamentaux en faveur du grand capital et contre les biens communs |8|. Toutes ces nouvelles mesures et contre-réformes renforcent l’injustice et la précarité. Si les créanciers finissent par accorder un nouveau réaménagement de la dette |9|, ce sera à la condition de poursuivre le même type de politiques. Dans ce cas, une réduction de dette ne constituera en rien une victoire ou même une consolation. Ce sera seulement une mesure visant à garantir la poursuite des remboursements et tenter d’éviter une reprise vigoureuse des luttes sociales.
Une première conclusion s’impose : sans prendre des mesures souveraines et unilatérales fortes d’autodéfense, les autorités nationales et les peuples qui les ont mandatées pour rompre avec l’austérité ne pourront pas mettre fin à la violation des droits humains perpétrée à la demande des créanciers et des grandes entreprises privées.
Certains pourraient rétorquer que si un gouvernement de gauche venait au pouvoir à Madrid, il pourrait utiliser le poids de l’économie espagnole (4e économie de la zone euro à l’aune du PIB) dans la négociation avec les principaux gouvernements de la zone euro et obtenir des concessions que Tsipras ne pouvait pas obtenir. Quelles concessions ? La possibilité de relancer l’économie et l’emploi par des dépenses publiques massives et donc avec un déficit public considérable ? Berlin, la BCE et au moins 5 ou 6 autres capitales de la zone euro s’y opposeront ! La possibilité de prendre des mesures très fortes à l’égard des banques ? La BCE appuyée par la Commission rejettera cette option.
Ce qui est également sûr, c’est que si des forces de gauche radicale accédaient au gouvernement dans des pays comme le Portugal, Chypre, l’Irlande, la Slovénie, les 3 républiques baltes, ils n’auraient pas les moyens de convaincre la commission et la direction de la BCE de les laisser mettre fin à l’austérité, arrêter les privatisations et développer les services publics, réduire radicalement la dette… Ces gouvernements devront résister et prendre des mesures unilatérales pour défendre leur population. Et si plusieurs gouvernements de gauche se mettaient en place simultanément dans plusieurs pays de la zone euro et exigeaient ensemble une renégociation ? Bien sûr ce serait une très bonne chose mais cette possibilité est également à exclure ne fût-ce que pour des raisons de calendrier électoral.
Est-ce qu’un gouvernement de gauche au pouvoir à Paris, en cas de victoire de Mélenchon à la présidentielle de mai 2017 et des forces de gauche radicale aux législatives qui suivront, pourrait forcer à une réforme de l’euro ? C’est l’hypothèse de l’équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon. On peut raisonnablement douter de cette possibilité. Admettons que JL Mélenchon accède à la présidence et constitue un gouvernement. Il voudra appliquer un ensemble de mesures de justice sociale et tenter d’obtenir une réforme de l’euro. Qu’est-ce qui serait possible ? Ce qui est tout à fait possible pour un gouvernement de gauche en France, c’est de désobéir aux traités et de faire respecter son choix mais il ne pourra pas obtenir une réforme profonde de la zone euro. Pour obtenir cela, il faudrait des victoires électorales simultanées tant dans les principaux pays que dans plusieurs pays de la périphérie. Ceci dit, il est clair qu’un gouvernement de la France insoumise et de ses alliés qui prendrait des mesures unilatérales en faveur de la population de la France et des peuples du monde (par exemple annuler de manière unilatérale les dettes de la Grèce et des pays dits en développement à l’égard de la France) pourrait jouer un rôle positif en Europe.
Une stratégie internationaliste qui prône une intégration européenne des peuples en faisant ces constats, il ne s’agit pas de chercher une issue nationaliste à la crise. Tout autant que par le passé, il est nécessaire d’adopter une stratégie internationaliste et de prôner une intégration européenne des peuples opposée à la poursuite de l’intégration actuelle qui est totalement dominée par les intérêts du grand capital.
Les maillons faibles de la chaîne de domination intra-européenne se trouvent dans les pays périphériques. Si Syriza avait adopté une stratégie correcte, un tournant positif aurait pu être pris en 2015. Cela n’a pas été le cas. Les autres maillons faibles de la chaîne où la gauche radicale peut accéder au gouvernement dans les années à venir sont notamment l’Espagne et le Portugal. Peut-être est-ce également possible dans les années qui viennent en Irlande, en Slovénie, à Chypre etc. Cela dépendra de plusieurs facteurs : la capacité de la gauche radicale de tirer les leçons de l’année 2015 et d’avancer des propositions anticapitalistes et démocratiques qui entraînent l’adhésion… Cela dépendra sans le moindre doute du degré de mobilisation populaire… S’il n’y a pas une pression de la rue, des quartiers, des lieux de travail pour des changements réels et pour refuser les compromis boiteux, l’avenir sera glauque.
Dix propositions afin de ne pas reproduire la capitulation que nous avons connue en Grèce
Pour éviter de reproduire la capitulation que nous avons connue en Grèce en 2015, voici dix propositions pour la mobilisation sociale et l’action d’un gouvernement réellement au service du peuple à mettre en œuvre immédiatement et simultanément.
La première proposition est la nécessité, pour un gouvernement de gauche, de désobéir, de manière très claire et annoncée au préalable, à la Commission européenne. Le parti qui prétend, ou la coalition de partis qui prétendent gouverner et, bien sûr, nous pensons à l’Espagne, devront refuser d’obéir, dès le début, aux exigences d’austérité, et s’engager à refuser l’équilibre budgétaire. Il faudra dire : « Nous ne respecterons pas l’obligation décrétée par les traités européens de respecter l’équilibre budgétaire parce que nous voulons augmenter les dépenses publiques pour lutter contre les mesures antisociales et d’austérité, et pour entreprendre la transition écologique ». Par conséquent, le premier point est de s’engager d’une manière claire et déterminée à désobéir. Après la capitulation grecque, il est essentiel d’abandonner l’illusion d’obtenir de la Commission européenne et des autres gouvernements européens qu’ils respectent la volonté populaire. Conserver cette illusion nous conduirait au désastre. Nous devons désobéir.
Deuxième point : S’engager à appeler à la mobilisation populaire. Tant au niveau de chaque pays qu’au niveau européen. Cela aussi a échoué en 2015 en Grèce et en Europe. Il est évident que les mouvements sociaux européens ne furent pas à la hauteur en termes de manifestations, qui certes eurent lieu, mais ne montrèrent pas un niveau suffisant de solidarité avec le peuple grec. Mais il est vrai aussi que l’orientation stratégique de Syriza ne prévoyait pas de faire appel à la mobilisation populaire au niveau européen, ni même de faire appel à la mobilisation populaire en Grèce. Et quand le gouvernement de Tsipras a appelé à la mobilisation par le référendum du 5 Juillet 2015, ce fut pour ensuite ne pas respecter la volonté populaire de 61,5 % des Grecs, qui avaient refusé d’obéir aux exigences des créanciers et avaient rejeté leurs propositions.
Rappelons-nous qu’à partir de la fin février 2015 et jusque fin juin 2015, Yanis Varoufakis et Alexis Tsipras ont fait des déclarations qui visaient à convaincre l’opinion qu’un accord était en vue et que les choses s’arrangeaient. Imaginons au contraire qu’après chaque négociation importante, ils aient expliqué les enjeux, au travers de communiqués, par des déclarations orales aux médias, par des prises de parole sur les places publiques, devant le siège des institutions européennes à Bruxelles et ailleurs. Imaginons qu’ils aient fait la lumière sur ce qui se tramait, cela aurait abouti à des concentrations de milliers ou de dizaines de milliers de personnes, les réseaux sociaux auraient relayé à des centaines de milliers ou des millions de destinataires ce discours alternatif.
Troisième point : S’engager à organiser un audit de la dette avec la participation des citoyens. Les situations dans les 28 pays de l’Union européenne sont différentes, de même bien sûr à l’intérieur de la zone euro. Il y a des pays européens où la suspension des remboursements est une mesure de nécessité absolue et prioritaire, comme dans le cas de la Grèce dans le but de répondre avant tout aux besoins sociaux et de garantir les droits humains fondamentaux. C’est aussi un élément clé d’une stratégie d’autodéfense. En Espagne, au Portugal, à Chypre, en Irlande, cela dépend du rapport de force et de la conjoncture. Dans d’autres pays, il est possible de réaliser d’abord l’audit et ensuite décider de la suspension des remboursements. Ces mesures doivent être mises en œuvre en tenant compte de la situation spécifique de chaque pays.
Quatrième mesure. Mettre en place un contrôle des mouvements de capitaux. Et tenir compte de ce que cela signifie. C’est à dire aller à l’encontre de l’idée selon laquelle il serait interdit aux citoyens de transférer quelques centaines d’euros à l’étranger. Il est évident que les transactions financières internationales seront autorisées jusqu’à un certain montant. Par contre, il s’agit de mettre en place un contrôle strict sur les mouvements de capitaux au-dessus de ce montant.
Cinquième mesure : Socialiser le secteur financier et le secteur de l’énergie. Socialiser le secteur financier ne consiste pas seulement à développer un pôle bancaire public. Il s’agit de décréter un monopole public sur le secteur financier, à savoir les banques et les sociétés d’assurance. Il s’agit d’une socialisation du secteur financier sous contrôle citoyen. C’est-à-dire transformer le secteur financier en service public |10|. Dans le cadre de la transition écologique, bien sûr, la socialisation du secteur de l’énergie est également une mesure prioritaire. Il ne peut y avoir de transition écologique sans monopole public sur le secteur de l’énergie, tant au niveau de la production que de la distribution.
Proposition numéro six : Création d’une monnaie complémentaire, non convertible et l’inévitable débat sur l’euro. Que ce soit dans le cas d’une sortie de l’euro ou d’un maintien dans la zone euro, il est nécessaire de créer une monnaie complémentaire non convertible. Autrement dit, une monnaie qui sert, en circuit court, aux échanges à l’intérieur du pays. Par exemple, pour le paiement de l’augmentation des retraites, des augmentations de salaire aux fonctionnaires, pour le paiement des impôts, pour le paiement des services publics … Utiliser une monnaie complémentaire permet de se détacher et de sortir partiellement de la dictature de l’euro et de la Banque centrale européenne.
Bien sûr, on ne peut pas éviter le débat sur la zone euro. Dans plusieurs pays, la sortie de la zone euro est également une option qui doit être défendue par les partis, les syndicats, d’autres mouvements sociaux. Plusieurs pays de la zone euro ne pourront pas réellement rompre avec l’austérité et lancer une transition écosocialiste sans quitter la zone euro. Dans le cas d’une sortie de la zone euro, il faudrait soit mettre en œuvre une réforme monétaire redistributive |11| soit appliquer un impôt exceptionnel progressif au-dessus de 200 000 €. Cette proposition ne concerne que le patrimoine liquide, elle ne concerne donc pas le patrimoine immobilier (maisons, etc.) évoqué dans la septième mesure.
La septième mesure : une réforme radicale de la fiscalité. Supprimer la TVA sur les biens et les services de consommation de base, comme la nourriture, l’électricité, le gaz et l’eau (pour ces trois derniers, jusqu’à un certain niveau de consommation par individu) |12|, et d’autres biens de première nécessité. Par contre, une augmentation de la TVA sur les biens et les produits de luxe, etc. Nous avons aussi besoin d’une augmentation des impôts sur les bénéfices des entreprises privées et des revenus au-dessus d’un certain niveau. Autrement dit, un impôt progressif sur les revenus et sur le patrimoine. La maison d’habitation devrait être exonérée d’impôt en dessous d’un certain montant qui varie en fonction de la composition du foyer. La réforme de la fiscalité doit produire des effets immédiats : une baisse très sensible des impôts indirects et directs pour la majorité de la population et une augmentation très sensible pour les 10 % les plus riches et pour les grandes entreprises. Enfin, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale serait intensifiée.
Huitième mesure : Déprivatisations. « Racheter » les entreprises privatisées pour un euro symbolique. Ainsi, de ce point de vue, utiliser l’euro pourrait s’avérer très sympathique, en payant un euro symbolique à ceux qui ont profité des privatisations. Et renforcer et étendre les services publics sous contrôle citoyen.
Neuvième mesure : La mise en œuvre d’un vaste plan d’urgence pour la création d’emplois socialement utiles et pour la justice. Réduire le temps de travail avec maintien des salaires. Abroger les lois antisociales et adopter des lois pour remédier à la situation de la dette hypothécaire abusive, des dispositions qui concernent en priorité des pays comme l’Espagne, l’Irlande, la Grèce… Cela pourrait très bien se résoudre par la loi, en évitant des procès (car il y a de nombreux procès sur la dette hypothécaire où les ménages sont confrontés aux banques). Un Parlement peut décréter par une loi l’annulation des dettes hypothécaires inférieures à 150 000 euros par exemple et mettre ainsi un terme à des procédures judiciaires. Il s’agit aussi de mettre en œuvre un vaste programme de dépenses publiques afin de relancer l’emploi et l’activité socialement utile en favorisant les circuits courts.
Dixième mesure : Entamer un véritable processus constituant. Il ne s’agit pas de changements constitutionnels dans le cadre des institutions parlementaires actuelles. Il s’agirait de dissoudre le parlement et de convoquer l’élection au suffrage direct d’une Assemblée constituante. Et de rechercher à insérer ce processus dans d’autres processus constituants au niveau européen.
Ce sont dix propositions de base à soumettre au débat. Mais une chose est certaine, les mesures à prendre doivent aller à la racine des problèmes et elles doivent être appliquées simultanément car il faut un programme cohérent. En l’absence de la mise en œuvre de mesures radicales annoncées depuis le début, il n’y aura pas de rupture avec les politiques d’austérité. Il est impossible de rompre avec les politiques d’austérité sans prendre des mesures radicales contre le grand capital. Ceux qui pensent que l’on peut éviter cela sont des « enfumeurs » qui ne pourront pas obtenir de réelles avancées concrètes. Au niveau européen, la nature de l’architecture européenne et l’ampleur de la crise du capitalisme font qu’il n’y a pas de réel espace pour des politiques productivistes néo-keynésiennes. L’écosocialisme ne doit pas être à la marge mais au cœur du débat, d’où doivent venir les propositions immédiates et concrètes. Il faut mener à bien la lutte contre l’austérité et se lancer sur le chemin de l’anticapitalisme. La transition écosocialiste est une nécessité absolue et immédiate.
Notes :
|1| Dans le cas de la Grèce, il s’agissait des banques grecques, françaises, allemandes, belges et hollandaises principalement (une quinzaine de grandes banques privées pour donner une idée approximative). Pour une analyse détaillée voir Rapport préliminaire de la Commission pour la vérité sur la dette publique grecque, juin 2015, chapitres 1 et 2 Intervention d’Éric Toussaint à la présentation du rapport préliminaire de la Commission de la vérité le 17 juin 2015; voir aussi « Grèce : Les banques sont à l’origine de la crise », publié le 23 décembre 2016, http://www.cadtm.org/Grece-Les-banq…
Enfin voir : Documents secrets du FMI sur la Grèce avec commentaires d’Éric Toussaint (CADTM)
|2| À cette époque, les activités de plusieurs des grandes banques françaises, allemandes, hollandaises, belges, etc. concernées étaient fortement imbriquées avec les marchés financiers aux États-Unis et avec les plus grandes banques des États-Unis et du Royaume-Uni. En plus, et c’est lié, elles avaient accès à une importante ligne de crédit offerte par la Réserve fédérale des États-Unis, d’où l’intérêt porté par l’administration de Barack Obama à la crise grecque et irlandaise, et plus généralement à la crise bancaire européenne.
|3| Dans le cas de la Grèce, il s’agissait de 14 États de la zone euro « représentés » par la Commission européenne, le FESF –Fonds européen de stabilité financière- (auquel a succédé le MES –Mécanisme européen de stabilité), la BCE et le FMI.
|4| Ce dernier aspect est souvent insuffisamment pris en compte car l’accent est mis sur les aspects économiques et sociaux. La tendance autoritaire à l’intérieur de l’UE et de la zone euro est pourtant à la fois un enjeu central et un objectif poursuivi de manière délibérée par la Commission européenne et le grand capital. Cela touche le renforcement du pouvoir exécutif, le recours à des procédures expéditives de vote, la violation ou la limitation d’une série de droits, le non-respect des choix des électeurs, l’augmentation de la répression de la protestation sociale…
|5| Lors des élections législatives du 4 octobre 2015, les forces de gauche, ont obtenu la majorité absolue des sièges à l’Assemblée nationale : le PS venait en deuxième position, avec 32,4 % ; le Bloco de Esquerda (Bloc de gauche), est arrivé en troisième position avec 10,3 %, et 19 députés (8 en 2011) ; le PCP gagne un siège et dispose de 15 députés ; le parti vert, PEV reste inchangé avec 2 sièges.1 Un accord de gouvernement a été conclu en novembre 2015 : le PS gouverne seul et les deux autres partis plus radicaux (BE et PCP), tout en refusant d’entrer au gouvernement, soutiennent au Parlement ses décisions quand elles leur conviennent.
|6| Cf. : http://www.latribune.fr/actualites/…
|7| Pour ne citer que quelques exemples : la France de Nicolas Sarkozy et l’Allemagne d’Angela Merkel n’ont pas été sanctionnées malgré le non-respect de leurs obligations en matière de déficit ; plus récemment, la Commission a été également laxiste à l’égard du gouvernement de Mariano Rajoy en 2015 et en 2016.
|8| Modification de la législation afin qu’en cas de faillite d’une entreprise, les banques créancières passent avant les salariés et les retraités -de l’entreprise- (été 2015) ; marginalisation complète des pouvoirs publics dans l’actionnariat des banques (décembre 2015) ; pouvoir accru de l’organisme indépendant de collecte des impôts ; nouveaux reculs dans le régime des retraites ; nouveaux reculs dans le code du travail ; instauration d’un mécanisme de coupes budgétaires automatiques en cas d’écart des objectifs d’excédents budgétaires inscrits dans le marbre du 3e Mémorandum. On constate également une aggravation de l’endettement des ménages.
|9| La dette a déjà été restructurée en 2012. Les autorités européennes avaient annoncé une réduction de 50 % de la dette grecque. En réalité, l’augmentation de la dette a repris de plus belle aussitôt après la restructuration. Les mesures annoncées en décembre 2016 constituent une véritable comédie (voir Michel Husson)
|10| Pour une explication à propos de la socialisation des banques, voir Que faire des banques? Version 2.0
|11| En appliquant un taux de change progressif au passage de l’euro à la nouvelle monnaie on diminuerait le liquide en possession du 1 % le plus riche et redistribuerait la richesse liquide aux ménages.
|12| Cela peut être combiné avec des mesures de gratuité sur la consommation d’eau, d’électricité, de gaz, etc. par individu et jusqu’à un certain niveau de consommation.
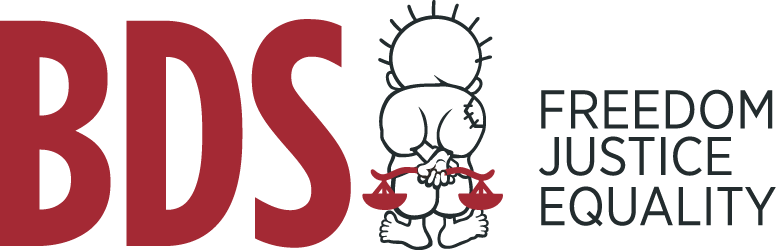
21-03-2017
Le Boycott académique et culturel d’Israël: Pourquoi? Pour – quoi?
Un bref rappel
C’est en 2005 que plus de 150 organisations et fédérations palestiniennes lancent leur appel au boycott, au désinvestissement et aux sanctions. Elles
«invitent les organisations des sociétés civiles internationales et les gens de conscience du monde entier à imposer de larges boycotts et à mettre en application des initiatives de retrait d’investissement contre Israël, semblables à ceux appliqués en Afrique du Sud à l’époque de l’Apartheid. Nous vous appelons à faire pression sur vos États respectifs afin qu’ils appliquent des embargos et des sanctions contre Israël. Nous invitons également les Israéliens scrupuleux à soutenir cet appel dans l’intérêt de la justice et d’une véritable paix.»
Ainsi est né le fameux mouvement BDS contre les politiques israéliennes d’occupation et de colonisation. Les raisons principales en étaient l’échec des Accords d’Oslo (accélération de la colonisation, répressions de toutes les formes, non violentes et violentes, de résistance, etc.), ainsi que la paralysie internationale et européenne un an après que l’ONU eut adopté une résolution, la résolution ES 10/15, consacrant fin juillet 2004 l’avis de la Cour internationale de Justice de La Haye contre le mur israélien et son système associé (début juillet 2004).
Ce que l’on oublie généralement, c’est qu’un autre « appel » avait précédé celui-là : l’« appel au boycott académique et culturel », signé par plus de cent organisations et fédérations palestiniennes, représentant bien l‘ensemble de la société civile palestinienne.
Avant d’analyser plus en profondeur la pertinence et l’importance stratégique de cet appel et d’en restituer le sens profond, contre diverses incompréhensions ou hésitations, il est bon de prendre connaissance une fois pour toutes de l‘entièreté de cet appel, souvent méconnu et travesti.
Le texte de l’appel au boycott universitaire et culturel
Attendu que l’oppression coloniale, fondée sur l’idéologie sioniste, qu’Israël exerce sur le peuple palestinien comporte les éléments suivants:
– le déni de sa responsabilité dans la Nakba – notamment dans les vagues d’épuration ethnique et les spoliations qui sont à l’origine du problème palestinien – et, en conséquence, son refus de reconnaître les droits inaliénables des réfugiés et des personnes déplacées tels que définis et protégés par les lois internationales,
– l’occupation militaire et la colonisation de la Cisjordanie (y compris Jérusalem-est) depuis 1967, en violation des lois internationales et des résolutions de l’ONU,
– la mise en place d’un système de discrimination raciale et de ségrégation des Palestiniens citoyens d’Israël, comparable à l’ancien système d’apartheid en Afrique du Sud,
Attendu que les institutions universitaires israéliennes (la plupart contrôlées par l’État) et la majorité des intellectuels et universitaires israéliens contribuent directement au maintien, à la défense et à la justification des formes d’oppression décrites ci-dessus ou s’en rendent complices par leur silence,
Attendu que toutes les interventions internationales n’ont pas réussi à contraindre Israël à respecter le droit humanitaire ou à mettre fin à l’oppression du peuple de Palestine, oppression qui s’exerce de multiples façons, notamment en assiégeant, en tuant indistinctement, en détruisant gratuitement, en construisant ce mur raciste,
Considérant le fait qu’au sein de la communauté universitaire et intellectuelle internationale, des hommes et des femmes de conscience ont historiquement endossé la responsabilité morale de combattre l’injustice, comme l’a montré leur lutte pour abolir l’apartheid en Afrique du Sud grâce à diverses formes de boycott,
Conscient que l’expansion du mouvement de boycott international contre Israël rend nécessaire la rédaction de ses lignes directrices,
Dans un esprit de solidarité internationale, de cohérence morale et de résistance à l’injustice et à l’oppression,
Nous, universitaires et intellectuels palestiniens, appelons nos collègues de la communauté internationale à boycotter toutes les institutions universitaires et culturelles israéliennes, afin de contribuer à la lutte pour mettre fin à l’occupation israélienne, à la colonisation et au système d’apartheid, en adoptant les pratiques suivantes :
– s’abstenir de toute participation, sous quelque forme que ce soit, à la coopération universitaire et culturelle, à des collaborations ou des projets communs en partenariat avec les institutions israéliennes,
– plaider en faveur du boycott complet des institutions israéliennes aux niveaux national et international, y compris la suspension de toute forme de financement et de subvention de ces institutions,
– encourager les désinvestissements et le désengagement vis-à-vis d’Israël de la part des institutions universitaires internationales,
– œuvrer en faveur de la condamnation de la politique d’Israël en incitant les associations et des organisations universitaires, professionnelles ou culturelles, à adopter des résolutions,
– soutenir directement les institutions universitaires et culturelles palestiniennes sans faire de leur éventuel partenariat avec leurs homologues israéliens une condition implicite ou explicite de ce soutien.
L’importance fondamentale et stratégique du boycott académique et universitaire d’Israël : analyses et arguments de Eyal Sivan et de Armelle Laborie
« Nous connaissons tous le cinéaste israélien Eyal Sivan. En octobre 2009 il avait décliné l’invitation qui lui avait été faite par le Forum des Images d’être associé à une rétrospective intitulée Tel Aviv, le paradoxe, et qui bénéficiait du soutien du gouvernement israélien. En y présentant son film « Jaffa, la mécanique de l’orange », il aurait participait à un événement célébrant des artistes et des cinéastes, qui, comme il l’écrivait aux organisateurs, célèbrent des artistes et des cinéastes qui évitent « de s’exprimer clairement au sujet de la brutale répression des populations palestiniennes. Ce sont les arguments invoqués dans cette lettre qu’il reprend et développe dans un livre écrit en collaboration avec la productrice Armelle Laborie, et qui est sorti en librairie le 21 octobre 2016.
Contre ceux, encore trop nombreux, qui soutiennent que « l’université et la culture seraient par nature situées au-delà des querelles politiques », les deux auteurs montrent qu’aujourd’hui les productions culturelles et les institutions de savoir sont, à la différence des kumquats et des avocats ou même des armements, clairement identifiées à une nation. Dans la mesure où les institutions universitaires et culturelles forment une « vitrine dans laquelle Israël présente d’elle-même une image démocratique, libérale et critique », l’appel au boycott est comme « un pavé lancé dans cette vitrine ».
Devant le ralliement de plus en plus d’universitaires et d’artistes à la campagne BDS, désormais coordonnée au niveau international par le PACBI, les autorités israéliennes perçoivent la menace, et mettent en place un impressionnant dispositif de propagande, la hasbara, le terme hébreu pour explication, qui, en 2016, a été dotée d’un budget de 30 millions d’euros. Un ministre, Gilad Erdan, est même désigné pour mener à bien le combat contre BDS. Il s’agit de restaurer l’image d’Israël et tous les moyens vont être bons, qu’il s’agisse de proposer une image positive d’Israël ou de conduire une cyber-guerre, voire une guerre juridique globale. On se souvient qu’en mars 2016, un autre ministre, Israël Katz, a même annoncé « l’élimination civile ciblée » des principaux militants du BDS.
Eyal Sivan et Armelle Laborie répondent point par point à tous ces arguments de propagande. Ils montrent avec précision, que l’université israélienne, loin d’être le lieu d’une culture pluraliste et dynamique, non seulement garde le silence sur l’occupation et les crimes de guerre, mais sert d’auxiliaire à l’armée et fabrique des discriminations. Défendre le boycott universitaire, ce n’est en aucun cas s’opposer aux libertés académiques, c’est au contraire permettre de les développer, d’autant plus que tel qu’il est défini dans les directives de PACBI, le boycott n’empêche nullement la collaboration avec des universitaires israéliens pris à titre individuel. Et il offre même une possibilité d’expression et d’échange à tous ceux qui souffrent d’un isolement croissant.
La culture israélienne, telle qu’elle s’est affichée, par exemple à Paris, au Salon du livre de 2008, jouit d’un grand prestige en Occident. Cependant « elle est en complet décalage avec la réalité israélienne ». Les écrivains et les cinéastes considérés comme appartenant au « Camp de la paix » et qui sont tellement présents sur la scène nationale, constituent en quelque sorte une « dissidence officielle », qui participe à la représentation d’un État d’Israël juif et démocratique où régnerait la liberté d’expression.
Or cette gauche sioniste, dont ces artistes sont les porte-drapeaux et qui défend ses propres libertés sans trop s’inquiéter des atteintes aux libertés des Palestiniens, permettant de « chanter les louanges de la seule démocratie au Moyen-Orient », n’a jamais été inquiétée par le pouvoir, parce qu’en fait elle le légitime et l’a toujours servi sans broncher. Les institutions auxquelles ils appartiennent et qu’ils défendent sont devenues « un atout solide pour la communication de tous les gouvernements, et un instrument privilégié de la « hasbara-marketing ».
Israël qui se considère et est reconnu comme une démocratie occidentale, revendique cependant un statut singulier l’autorisant à violer impunément les droits humains. Israël jouit donc « d’un statut d’État d’exception ». Il est fort inquiétant de penser que ce modèle d’état d’urgence permanent est en train de devenir une référence y compris en France. C’est cette exception qu’il s’agit de boycotter, en exerçant « une pression citoyenne non-violente » pour forcer cet État à se plier aux exigences du droit international et devenir ainsi un État normal, qui cesse d’être hors-la-loi. La campagne BDS qui exige qu’il soit mis fin à l’impunité d’Israël est donc légitime. Ce mouvement « polymorphe et rhizomique » est également juste et urgent. Juste, parce que c’est un acte de solidarité envers les Palestiniens, mais aussi envers les Israéliens anticoloniaux. Urgent, « car la société israélienne est en processus de fascisation ».
La lecture du livre d’Eyal Sivan et Armelle Laborie, dont il faut saluer le courage et la détermination, est elle aussi urgente. Elle est même indispensable. Tous les éléments de la hasbara (justification, propagande) y sont pointés et démontés. On y trouve tous les arguments permettant de répondre à la propagande israélienne dont nous sommes abreuvés en permanence. Mais on le referme aussi avec le sentiment qu’un espoir reste possible pour la construction de ce monde commun auquel nous aspirons.
Appels en France et en Belgique
Dans un article précédent (Goosch.lu, 10 février 2017), nous avons donné de nombreux exemples de ce boycott académique et culturel parmi les nombreux pays où des organisations soutenant les droits des Palestiniens ont adopté l’appel palestinien au boycott académique et culturel, nous n’en citerons que deux, à titre d’exemple.
L’appel belge par le BACBI (Boycott Académique et Culturel Belge d’Israël) http://www.bacbi.be/cult/declaration-bacbi.htm
Et l’appel en France : le boycott universitaire : https://www.bdsfrance.org/category/bds-quest-ce-que-cest/c31-le-boycott-universitaire/
Des textes législatifs importants et récents
Plusieurs textes de hautes instances internationales, ainsi qu’une loi votée récemment en Israël confirment largement l’importance stratégique et fondamentale du boycott académique et universitaire d’Israël bien compris. Je n’en cite que les principaux, les plus récents :
ONU:
– Résolution 2334 du 23 décembre 2016 sur l’illégalité des colonies (2016)
– Rapport de son importance pour L’Observatoire Euro-Méditerranéen pour droits de l’homme
– Rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie Occidentale
– Retrait de ce rapport sous la pression des USA et d’Israël :
UE:
– Nouveau rapport 2016 des chefs de postes européens à Jérusalem inquiétant
En Israël
– Loi du 7 mars contre le BDS (1), (2)
Et pour terminer, l’histoire continue
Depuis le 7 mars, après le vote de cette loi israélienne, plusieurs militants du BDS ont été interdits d’entrée en Israël, dont, ce dimanche 13 mars, Hugh Lanning, président du PSC britannique (Palestine Solidarity Campaign), et représentant de la Grande-Bretagne à l’ECCP (la coordination européenne des associations pour la Palestine).
L’histoire peut continuer aussi avec nous, si nous acceptons de comprendre mieux l’importance fondamentale et stratégique du boycott académique et culturel d’Israël et de dépasser les idées préconçues et souvent tronquées qui dominent à son sujet.

03-03-2017
« Podemos » devant des choix stratégiques!
L’Espagne vient de vivre les deux années politiques les plus mouvementées de son histoire récente. Doublement touché par la crise de 2008 et l’implosion de sa propre boule spéculative, le pays avait vu la création du ˮmouvement des indignésˮ en 2011, suite à l’augmentation des frais d’inscription universitaires de 42%. Ce mouvement a débouché en janvier 2014 sur la création de « Podemos » comme formation politique avec l’objectif de transposer la colère de la rue vers les parlements. En mai de la même année, « Podemos » faisait une percée avec 8% lors des élections européennes ! Lors des élections communales de mai 2015 les mairies de Madrid, Barcelone, et Valence étaient emportées par « Podemos ».
Tout, absolument tout, semblait alors possible. La révolution sociale par les urnes semblait a porté de main. Après la capitulation de Syriza en Grèce, la gauche européenne attendait les élections espagnoles avec impatience comme une seconde secousse contre l’ordre néolibéral…
Malheureusement le rêve à fait place à une douche froide. Deux ans après, Manuel Rajoy est toujours premier ministre, le parti conservateur reste le premier parti et le PSOE social-démocrate le second pilier du système bipartite, conserve sa deuxième position dans le parlement devant Podemos.
Où réside le problème ? Comment expliquer ce phénomène d’une façon logique ? Dans un pays avec 21% de la population au chômage, où la moitié de la jeunesse n’a pas de travail, où tous les secteurs du peuple ont été touchés par la régression sociale. Comment la caste maudite et discréditée des politiciens établis, ont pu résister à l’orage de deux élections en 7 mois ?
Une interrogation autocritique, mais en même temps objective et constructive s’impose. Lors du scrutin du 20 décembre 2015 et plus encore lors de celui du 26 juin 2016, plusieurs aspects négatifs dans l’attitude de « Podemos » sont devenues visibles. Il ne faut jamais perdre de vu que ce parti/mouvement c’est créer d’un mouvement social de protestation spontané et suite à l’initiative de quelques intellectuels. Il soufre donc de plusieurs faiblesses initiales :
(-) La première est à chercher dans la conception du parti comme ˮmachine de guerre électoraleˮ qui a comme but essentiellement de transposer la colère populaire en voix électorales. Podemos s’est configuré comme un parti centré clairement sur la compétition électorale et la communication politique qui néglige complètement non seulement l’organisation et la structuration de ses bases militantes par en bas, mais également tout travail d’implantation sociale et l’intervention dans des mouvements sociaux et des syndicats.
(-) L’effet d’une stratégie politique qui se base avant tout sur des techniques de communication a été de favoriser une structure hautement hiérarchisée, personnalisée et centralisée dans laquelle les directions locales et régionales ont été très subordonnées. La méthode majoritaire et plébiscitaire d’élection des organes internes qui disposent alors d’un de facto monopole de décision, a souvent débouché sur une paralysie organisationnelle.
(-) Le résultat de cette faiblesse est apparu clairement après la première ˮnon-victoireˮ le 20.12.15. La droite était restée le premier parti et le PSOE n’a pas été dépassé. L’intervalle entre les élections de décembre 2015 et celles du 26 juin 2016 a été marqué par les négociations sur l’investiture et la proposition de Podemos d’un gouvernement de coalition avec le PSOE.
Dans ce débat Podemos à fait mauvaise figure et a émis trop de messages contradictoires. Ils n’ont pas réussi à articuler un programme concret et clairement anti-austérité vis-à-vis du PSOE qui aurait fait apparaître clairement que ce dernier s’opposait à toute mesure anti-austérité sérieuse. Par contre ils ont multiplié les signes de compromis pourris, comme le renoncement de Podemos à la promesse de la fin de la «réforme du travail» du ˮsocialisteˮ Zappatero de 2011, qui a été voté jadis avec les voix du parti conservateur. Iglesias et Errejon iront même jusqu’à affirmer dans ces moments que la crise du régime aurait vécu et que Podemos doit et va devenir un parti normal… etc. Ou la déclaration de Pablo Iglesias qui dit: « Nous avons appris à Madrid et à Valence qu’on change les choses depuis les institutions. Cette imbécilité que nous disions quand nous étions d’extrême gauche, selon laquelle on change les choses dans la rue et non dans les institutions, est un mensonge ».
Le résultat de cette politique était en juin 2016 une campagne électorale molle, manquant de propositions concrètes et où les mobilisations sociales n’étaient tout simplement pas prévues par Podemos. Le programme était tout simplement faible et pas à la hauteur d’un parti radical de gauche. Un Parti « anti-système » qui transforme ses options politiques dans quelques mois pour une « alternance parlementaire » de coalition avec la social-démocratie, sans programme anti-austérité claire ne doit pas s’étonner quand il perd de crédibilité. Podemos ensemble avec I.U. a perdu 1 million de voix en sept mois d’intervalle (5 049734 contre 6 139494 en décembre 2015)!
La question nationale reste une plaie (ou si en veut, un problème) majeur en Espagne. Une grande partie de la classe ouvrière voit dans le séparatisme catalan et basque un danger matériel pour leur future. Le danger d’un nouveau nationalisme chauvin, des divisions réactionnaires supplémentaires et des discriminations, sont le cauchemar de beaucoup de travailleurs dans la péninsule. La position d’un référendum sur l’indépendance en Catalogne de Podemos inquiète beaucoup de ses sympathisants, (qui dans l’expectative d’une coalition Podemos-PSOE ont préférer voter PSOE pour éviter un processus d’éclatement dans l’état espagnole). Seule la perspective d’une société anti-capitaliste « internationaliste » pourra dompter l’égoisme nationaliste. Ce positionnement n’est pas claire dans l’attitude de Podemos.
Depuis le « P.P. » de Rajoy, avec l’appui des libéraux de ˮCiudadanosˮ et grace à l’abstention de la majorité des députés du PSOE a pu sauver son gouvernement. Après cette douche froide, Podemos a tenu un congrès le 11 février, lors du quel un recentrage vers les mouvements sociaux a été opéré. Pourtant avec 71 députés au parlement (et troisième force), ils ont dorénavant une force politique énorme pour appuyer chaque mouvement d’opposition extraparlementaire. Il semble que la majorité du parti autour de Pablo Iglesias, a compris les lacunes de Podemos et va s’engager a les combler. Les luttes sociales à venir vont démontrer ci les militants pourront prendre les choses en main. La formidable leçon de la biennale passée est qu’un parti « antisystème » ne pourra gagner sans que parallèlement une immense mobilisation de masse lui trace le chemin.

10-02-2017
En Espagne, un droit de mémoire toujours mis à mal
Paca Rimbau Hernández
En Espagne comme ailleurs, l’on entend des phrases conformistes et accommodantes, du genre «A quoi bon remuer le passé?», ou encore «à quoi bon rouvrir des plaies?», ou encore «Il faut regarder de l’avant», ou encore « dans une guerre chaque camp commet des atrocités». Une particularité plutôt espagnole, c’est pourtant que ces questions, emmenant à l’inaction et à l’amnésie, bénéficient depuis la fin de la guerre (1939) du soutien des forces politiques et militaires au pouvoir, héritières en bonne mesure de l’armée et de l’«esprit national» qui ont plongé les Espagnols dans une guerre devenue civile et dans un après-guerre qui a duré quarante ans et notamment quand on s’attaque à ladite «mémoire historique».
Loi d’amnistie
Francisco Franco est mort en novembre 1975 et sa tombe se trouve dans le «Valle de los Caídos» (Vallée des Tombés), monument qu’il a fait construire comme dernier hommage aux «héros et martyrs de la Croisade».
Un processus connu sous le nom de «Transición» (Transition) s’est initié ensuite, avec à la base un engagement des deux côtés, visant à ce qui avait déjà été prôné en 1956 par le Parti Communiste: la «réconciliation nationale». La méthode adoptée, hélas, n’a pas favorisé, loin de là, la solution. En octobre 1977, a été promulguée la loi d’amnistie qui a été appliquée aux opposants au franquisme et qui a permis la sortie de prison de centaines de personnes, mais qui a, également, empêché la mise en question des tortionnaires. L’article 2 est explicite: L’état espagnol renonce, par cette loi, à ouvrir tout procès ou à exiger des responsabilités contre «les crimes commis par les fonctionnaires et l’application de la loi contre l’exercice des droits des individus».
L’impunité était servie. Cette même loi a permis, en 2012, au «Tribunal supremo» (Cour suprême) d’accuser le juge Baltasar Garzón d’avoir commis un acte de prévarication, car en 2008 il avait voulu mener une enquête sur 114 000 disparus de la guerre.
Bilan de l’opération: des milliers de personnes restent en Espagne, en 2017, sans savoir où se trouvent leurs parents, leurs grands frères et sœurs, ou sans pouvoir faire valoir le droit de les enterrer et de leur dire -tout en se le disant à elles-mêmes et le disant aux membres plus jeunes de leur entourage- que si leur mort a été brutale, le combat contre l’amnésie finira par l’emporter sur la volonté de les ensevelir à toujours dans l’oubli.
Droit de mémoire
En 2016, partout, des commémorations liées au fatidique 18 juillet 1936 se sont déroulées. 18 de juillet qui a signé la condamnation de l’Espagne à une dictature pendant 40 ans et qui a ouvert les portes à l’horreur que l’Europe a connu jusqu’à 1945. Qui a semé nos pays de morts et d’orphelins, de rancœur et de désarroi, de blessures encore ouvertes pour beaucoup. Récemment, des manifestations ont revendiqué l’abrogation de la loi de 1977, qui reste une entrave majeure à l’accomplissement du devoir -et droit- de mémoire. Parce que, oui, se souvenir devrait servir à honorer et à apprendre à ne pas reproduire des erreurs, à rester vigilants et à ne pas conjuguer le verbe résister au passé.
Parler de mémoire pour moi rejoint Jorge Semprún, pour qui celle-ci, au lieu de nous coincer, devrait servir à nous faire avancer. Elle doit également nous renvoyer aux exemples de solidarité et d’engagement citoyen, qui, heureusement, sont nombreux dans l’Histoire et qui remettent à leur place les phrases si souvent entendues « les choses ne changeront jamais» ou «cela a toujours été ainsi». Car, comme le disait l’anarchiste italien Amedeo Bertolo, nous devrions garder le pessimisme pour des temps meilleurs.
Voici deux occasions de rafraîchir la «bonne» mémoire:
https://www.chem.lu/le-chem/espace-presse/communiques-de-presse/l-exposition-la-maternite-d-elne-s-installe-au-chem
http://kulturfabrik.lu/en/program/details/event/la-maternite-delne/




